Souffrance
Il m’arrive souvent, en lisant un ouvrage inspirant ou en accompagnant une personne en thérapie, d’être frappé par la résonance entre les mots et les expériences vécues. Ces rencontres entre la pensée et le vécu forment comme des passerelles : elles donnent chair à des concepts, et offrent aux expériences intimes un langage qui les éclaire.
C’est ce qui s’est produit récemment, à la croisée de deux sources : la lecture de l’excellent livre de Sophie Galabru Nos dernières fois (auquel je consacrerai bientôt un article entier), et plusieurs séances d’hypnose thérapeutique marquées par des récits de souffrances et de reconstructions. Ces deux univers m’ont conduit à réfléchir plus profondément à ce que signifie souffrir et surtout à la possibilité que la souffrance, loin d’être une simple déchéance, puisse devenir une source de vitalité, de sens et de transformation.
La dignité des larmes
La souffrance accompagne l’existence humaine comme une ombre indissociable de notre condition finie. Elle se donne d’abord comme expérience immédiate et brutale : douleur du corps, peine de l’âme, déchirement du deuil ou de l’échec. Pour Schopenhauer d’ailleurs (Le Monde comme volonté et comme représentation), la vie est fondamentalement souffrance, puisque la volonté est un désir perpétuel, jamais satisfait.
En 1859, C.Darwin bouleversa notre compréhension de la vie en affirmant que ce n’était pas le plus fort qui survivait, mais le plus apte, celui qui savait s’adapter. Transposée à l’expérience humaine de la souffrance, du traumatisme, cette intuition éclaire la voie de la résilience.
Il ne s’agit pas de nier la blessure ni de s’y soumettre, mais de découvrir, au cœur même de notre fragilité, les ressources intimes qui permettent de renaître autrement. Car le trauma, lorsqu’il demeure figé, imprime dans le corps, le cerveau et l’histoire personnelle une marque indélébile, condamnant celui qui s’y enferme à une répétition douloureuse. Mais si l’on accepte d’utiliser cette douleur avec vitalité, ce n’est pas un simple retour fantasmagorique à l’état antérieur que l’on poursuit : c’est un nouveau développement, une autre trajectoire possible de l’existence.
Gérard Ostermann, psychothérapeute-analyste, professeur de thérapeutique et médecin interniste, insiste sur la nuance décisive entre douleur et souffrance : la première est une sensation physiologique, brute et immédiate, tandis que la seconde est façonnée par nos représentations, nos récits, nos interprétations. C’est précisément là que la pensée de Boris Cyrulnik nous ouvre une perspective lumineuse : la mémoire, loin d’être un enregistrement figé, est une trame vivante qui se recompose sans cesse. En réécrivant le récit de l’événement, en le replaçant dans un horizon de sens nouveau, nous pouvons infléchir l’empreinte laissée par la blessure et, peu à peu, métamorphoser la souffrance en une force créatrice.
Article complémentaire : Boris Cyrulnik & Edgar Morin : Dialogue sur la nature humaine
Sophie Galabru écrit : « Le chagrin n’est pas indigne, la dignité n’exclut pas les larmes » (Nos dernières fois, p.108). Cette phrase simple et lumineuse met en tension nos représentations habituelles.
Trop souvent, nous associons la dignité au contrôle, à la maîtrise froide de soi, comme si la fragilité devait rester cachée. Pourtant, la douleur n’ôte rien à notre valeur : elle peut au contraire ouvrir un espace de vérité, un lieu où l’être se révèle dans sa profondeur.
En cabinet, il n’est pas rare que les consultants s’excusent en pleurant : « pardon, je craque », comme si les larmes étaient une faute, une preuve d’échec. Or, je vois au contraire dans ce jaillissement une force : le moment où la vulnérabilité ose se montrer, où le masque tombe, et où le vivant se réaffirme. Curieusement, personne ne s’excuse d’être heureux, de rire ou de rayonner… mais pleurer appellerait une justification. Pourquoi cette asymétrie ? Peut-être parce que la souffrance nous renvoie à l’impuissance, alors que la joie nous conforte dans l’illusion de maîtrise. Et pourtant, les deux sont des visages authentiques de notre humanité.
La souffrance : entre fatalité et responsabilité
Devant l’épreuve, nous oscillons souvent entre deux attitudes : la résignation (« il n’y a rien à faire ») ou la lutte acharnée (« je dois vaincre à tout prix »). Ces deux extrêmes enferment. Mais il existe une voie plus subtile : souffrir avec vitalité.
Souffrir avec vitalité, ce n’est ni se résigner, ni se raidir dans une force artificielle. C’est accepter que la douleur nous traverse sans nous détruire, et découvrir comment elle peut devenir ferment de transformation. Elle peut nourrir une nouvelle manière de penser, une créativité inattendue, un lien plus profond aux autres.
En thérapie, je constate que ce n’est pas tant la douleur brute qui écrase, mais davantage le sens qu’on lui attribue :
- « Si je souffre encore après toutes ces années, c’est que je suis faible. »
- « Un petit progrès ne sert à rien, il faudrait tout changer d’un coup. »
- « J’ai rechuté, je suis nul. »
Ces croyances abîment l’identité bien plus que la souffrance elle-même. Le travail hypnotique, dans ces cas-là, consiste à réapprendre à rencontrer la douleur autrement : non plus comme une condamnation, mais comme un signe de vie, une énergie qui demande à être entendue, digérée, transformée et redirigée.
Pour Sophie Galabru, un des remèdes consiste donc à « plonger et s’installer dans la durée » plutôt que d’adopter une « attitude panoramique ou comptable ». Elle prône une immersion totale, une incarnation dans le présent.
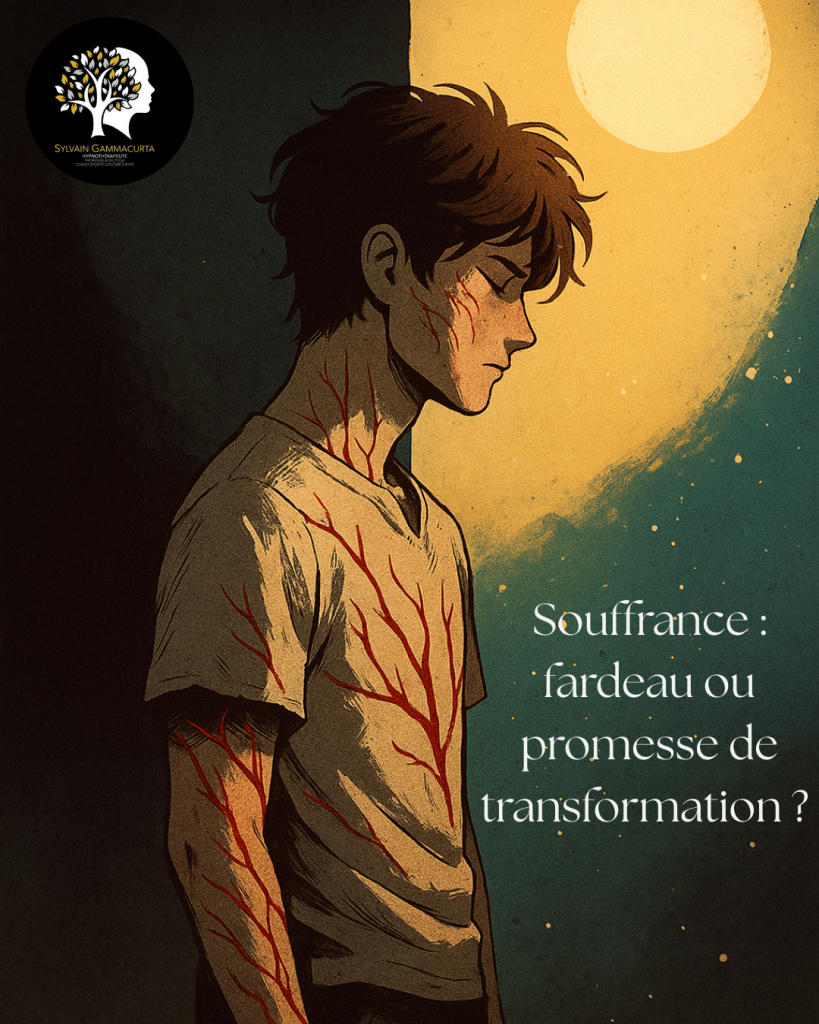
Viktor Frankl : donner un but à la souffrance
Viktor Frankl, psychiatre autrichien, rescapé des camps de concentration et fondateur de la logothérapie, nous a transmis une leçon essentielle : la souffrance devient traversable quand elle s’inscrit dans un horizon de sens.
« Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace réside notre pouvoir de choisir notre réponse. Dans notre réponse résident notre croissance et notre liberté. »
Ce n’est pas tant la douleur qui accable que l’incertitude de sa fin. Or, Frankl rappelle que nous pouvons nous donner un but, aussi minuscule soit-il. Ce but ne supprime pas la souffrance, mais il la transfigure en direction.
En séance, j’ai vu des personnes au bord du découragement retrouver une étincelle simplement en décidant d’arroser leurs plantes chaque matin, de marcher dix minutes, de parler à quelqu’un ou de s’autoriser simplement un temps de repos sans culpabilité… Des gestes modestes, mais qui réintroduisent progressivement un sentiment de responsabilité, de continuité et de présence au monde.
“Dans ce monde, tout sert à quelque chose, plus personne n’ose affirmer sa seule présence, et pourtant la philosophie partage avec la notion de dignité le fait de ne pas servir à, et précisément par ce geste de non négociation avec l’utilitarisme de préserver le sens de ce qui est réellement utile à l’homme, à savoir sa raison d’être.” V. Jankélévitch
Frankl insistait : l’être humain n’est pas entièrement conditionné. Même dans les situations les plus extrêmes, il conserve une liberté intérieure : celle de donner une signification à ce qu’il traverse. Autrement dit, il ne fait pas que subir : il peut façonner sa vie, acte après acte.
Nietzsche : l’éternel retour et la création de soi
Nietzsche nous interpelle avec une hypothèse vertigineuse : et si chaque instant devait revenir éternellement, serions-nous capables de dire « oui » à cette répétition infinie ?
À première vue, ce scénario semble insoutenable : qui voudrait revivre ses douleurs encore et encore ? Mais Nietzsche ne propose pas une boucle infernale : il nous invite à considérer chaque moment comme si nous devions l’habiter deux fois. La question est alors : si vous deviez revivre ce moment, voudriez-vous qu’il en soit autrement ?
Cette pensée exigeante nous pousse à investir chaque instant de toute notre intensité créatrice. Vivre selon l’éternel retour, ce n’est pas chercher le bonheur permanent, mais apprendre à aimer l’instant pour sa qualité, même lorsqu’il est douloureux, parce qu’il contribue à la construction de soi.
En thérapie, j’aime poser la question ainsi : « Et si ce que vous traversez n’était pas une punition, mais une répétition générale ? Comment aimeriez-vous le jouer la deuxième fois ? » Cet exercice déplace le regard : il transforme la plainte en responsabilité, et la souffrance, sans a nier, en appel à la création.
Pour E.Lévinas, dans « De l’existence à l’existant » décrit qu’avant même le rapport à autrui, l’être humain peut se vivre comme « existant seul« , enfermé dans la pesanteur de l’« il y a ». Dans cette expérience, le temps ne se renouvelle pas vraiment : il tourne en rond. L’instant n’apporte rien de neuf, il n’est qu’une continuité sans ouverture. Le sujet seul est condamné à répéter l’être, sans horizon véritable. Cette ouverture, Lévinas la pense à travers la rencontre avec autrui. Autrui introduit dans le temps une dimension irréductible à ma solitude : il apporte l’inattendu, la surprise, l’événement, l’enseignement que je n’aurais pu produire moi-même. Autrui est ce qui rompt la clôture de l’être, ce qui rend possible un instant qui n’est pas déjà la prolongation de mon passé.
Dans ce paradigme, l’avenir est impossible pour le sujet enfermé en lui-même, parce qu’il n’a accès qu’à une répétition du même. Le véritable avenir, le « vierge », l’inédit, ne naît qu’à partir de la relation, du face-à-face, de l’irruption de l’altérité.
Cette ouverture peut advenir au détour de n’importe quelle rencontre, dans le hasard le plus ordinaire comme dans l’évidence d’un lien choisi : elle peut surgir d’un visage croisé qui bouleverse mes certitudes, ou encore dans la relation de soin, avec un thérapeute dont la présence ne trace pas ma route à ma place mais m’invite à en explorer les détours, afin que je découvre par moi-même une voie plus juste et plus saine vers mon propre devenir.
Vladimir Jankélévitch : la fragilité des dernières fois
Le philosophe Vladimir Jankélévitch, maître de la nuance, a écrit : « Sous le soleil et même les recommencements, il n’y a rien à aimer comme si c’était la dernière fois, car tout est toujours une dernière fois. »
Chez Jankélévitch, l’instant porte une gravité particulière : il est unique, fragile, irréversible. Même les gestes les plus banals : un repas partagé, un sourire échangé, prennent une profondeur infinie lorsqu’on les vit comme s’ils ne devaient plus jamais revenir.
Cette pensée peut sembler mélancolique, mais elle est en réalité une invitation à l’intensité. Elle nous rappelle que rien n’est acquis, que chaque expérience est précieuse.
Dans l’accompagnement, je propose parfois d’explorer ces « dernières fois » : le dernier regard échangé avec un proche disparu, le dernier pas franchi dans une maison d’enfance, la dernière conversation avec un ami… Ces souvenirs ne servent pas à cultiver la nostalgie, mais à éveiller une conscience accrue de la valeur de ce qui reste à vivre, à condition qu’on y laisse un peu d’espace.
Quand j’étais plus jeune, j’avais l’impression que rien ne pouvait vraiment m’atteindre. Je portais mon armure sans fissure apparente, jusqu’au jour où les souffrances longtemps enfouies, ces douleurs que je n’avais jamais osé laisser entendre, se sont mises à frapper de l’intérieur. Incapable de les dire, de les offrir à une oreille qui saurait écouter et encore moins comprendre, je n’ai trouvé d’autre langage que celui du corps. Me lacérer, c’était alors, de façon tragique, rendre visible l’invisible, donner une forme tangible à ce qui n’osait pas se dire. Ce geste n’était pas une recherche de mort, mais une tentative maladroite d’existence : inscrire sur la peau la trace d’une douleur silencieuse, inavouable.
Il existe mille manières de tourner la souffrance contre soi plutôt que de la laisser se déployer plus sainement : l’autosabotage, les conduites à risque, la somatisation… autant de formes bancales de déplacement du problème, comme si l’énergie vitale, faute de lieu où s’exprimer, se retournait contre son porteur. Freud voyait déjà dans ces symptômes une « formation de compromis », où l’inexprimé trouve malgré tout un chemin détourné pour émerger. Winnicott, quant à lui, rappelait combien un environnement défaillant empêche parfois l’enfant et plus tard l’adulte de « jouer sa souffrance », de l’intégrer par la médiation symbolique. Lorsque la parole manque, le corps prend le relais.
Et pourtant, au cœur même de cette solitude intérieure, une brèche a fini par s’ouvrir. Car si la souffrance cherche toujours à se dire, elle peut aussi, lorsqu’elle rencontre l’écoute juste, se transformer en parole vivante. C’est là que réside le miracle discret de la rencontre thérapeutique, de l’écriture ou d’un visage bienveillant qui accueille sans juger.
Boris Cyrulnik a souvent décrit cette spirale où la mémoire traumatique, faute d’être narrée et reconnue, s’imprime en symptômes répétitifs qui enferment. Mais il montre aussi qu’il est possible, en modifiant le récit, de transformer la trace laissée par l’événement : « la parole guérit quand elle est entendue », écrit-il. Plus récemment, les recherches de Peter Levine (docteur en biophysique médicale et en psychologie, il a travaillé avec la NASA en tant que consultant en matière de stress) en Somatic Experiencing confirment ce que tant d’âmes blessées pressentaient : pour se libérer, le trauma doit trouver une voie d’expression qui associe à la fois le corps et le récit, la sensation et la symbolisation.
« Le traumatisme est peut-être la source la plus évitée, ignorée, niée, incomprise et non traitée de souffrance humaine. » Peter Levine
Ainsi, derrière mes gestes d’autrefois, il n’y avait pas seulement une autodestruction, mais une tentative maladroite de réparation. Ce n’était pas la souffrance en elle-même qui me détruisait, mais l’absence d’espace pour la dire, pour la partager, pour la métamorphoser en quelque chose de créatif et de vivant.
Article associé : Un été avec Jankélévitch
Conclusion : souffrir, créer, devenir
La souffrance n’est pas une fatalité qui condamne à l’impuissance. Elle peut devenir une porte d’entrée vers la création de soi.
Entre la logothérapie de Frankl, l’éternel retour de Nietzsche, le défi des dernières fois avec Sophie Galabru, la résilience de Cyrulnik… une exigence commune se dessine : faire de chaque instant un espace, une occasion de sens, de responsabilité et de vitalité.
Le paradoxe est que la souffrance n’est jamais pure promesse : elle est d’abord fardeau, mais c’est dans son accueil, sa traversée, son interprétation qu’elle peut devenir féconde.Toute transformation suppose donc un travail du sujet : effort narratif, sublimation créatrice, ou quête spirituelle…
La souffrance ne saurait être pensée de manière univoque : elle est selon moi à la fois fardeau et promesse. Fardeau lorsqu’elle enferme, lorsqu’elle réduit l’homme à sa vulnérabilité nue ; à son ressentiment et promesse lorsqu’elle devient occasion d’un dépassement, d’une création de soi, d’un approfondissement de l’existence.
La question n’est donc pas de savoir si la souffrance est bonne ou mauvaise en soi, mais comment nous la recevons, l’interprétons et la transformons. La philosophie, la psychologie et l’art nous rappellent alors une même exigence : ne pas fuir la souffrance, mais la traverser, pour y découvrir peut-être la possibilité d’une vie plus dense, plus responsable et plus humaine.
Chaque jour, dans la pratique thérapeutique, je vois combien il est possible de transformer la douleur en puissance d’agir. Une parole juste, une écoute bienveillante, un lien, une image hypnotique, un pas de coté, un projet minuscule… peuvent redonner de la dignité au cœur même de l’épreuve.
À méditer cette semaine
- Comment puis-je donner un but à ma souffrance aujourd’hui, aussi infime soit-il ?
- Si cet instant devait revenir une deuxième fois, aimerais-je le revivre tel qu’il est, ou puis-je le transformer en expérience créatrice ?
Pour aller plus loin
- Viktor Frankl, Découvrir un sens à sa vie
- Friedrich Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra
- Sophie Galabru, Nos dernières fois
- Vladimir Jankélévitch, Le Je-ne-sais-quoi et le presque-rien
Sylvain Gammacurta Hypnose
