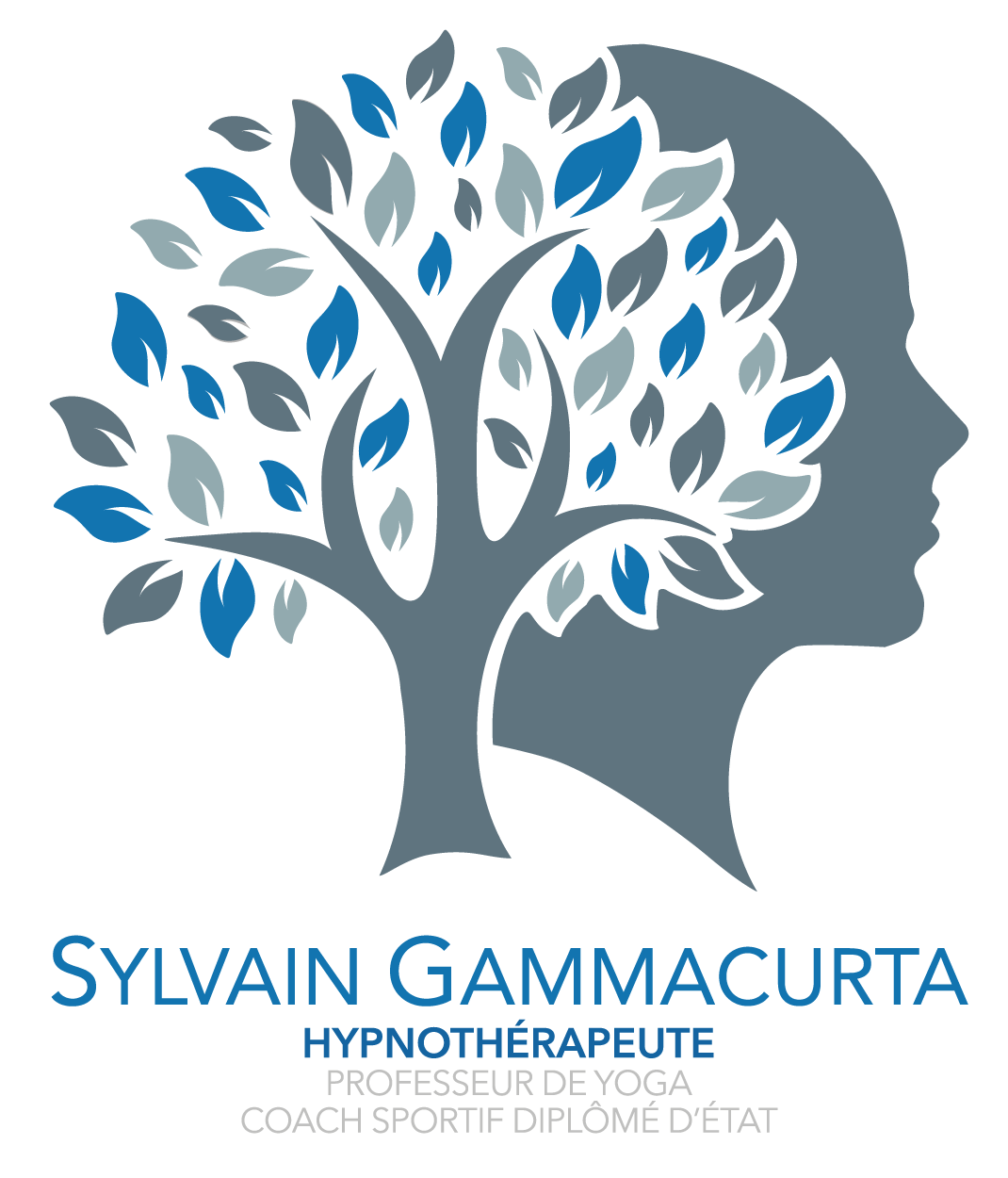Le langage du changement, Paul Watzlawick : Éléments de communication thérapeutique
Paul Watzlawick est un psychothérapeute, psychiatre. Il fut l’une des figures majeures de l’école de Palo Alto et du courant constructiviste.
Ce livre paru aux éditions points date un peu mais reste, je pense, riche d’informations incroyables pour tout thérapeute voulant s’imprégner de la philosophie du célèbre psychiatre.
Si l’on admet, tel que l’auteur, que nous avons deux façons de communiquer, l’une rationnelle et analytique, l’autre plus globalisante, « poétique » et figurative… C’est donc par cette dernière que se constitue, pour un sujet, son image du monde, cette mosaïque qui s’élabore à partir de myriades d’expériences, de convictions, d’influences et d’interprétations.
Or, selon Paul Watzlawick, tout changement thérapeutique est, en fait, un changement dans cette image.
Quels sont les moyens concrets de ce changement ? C’est ce qui est examiné ici.
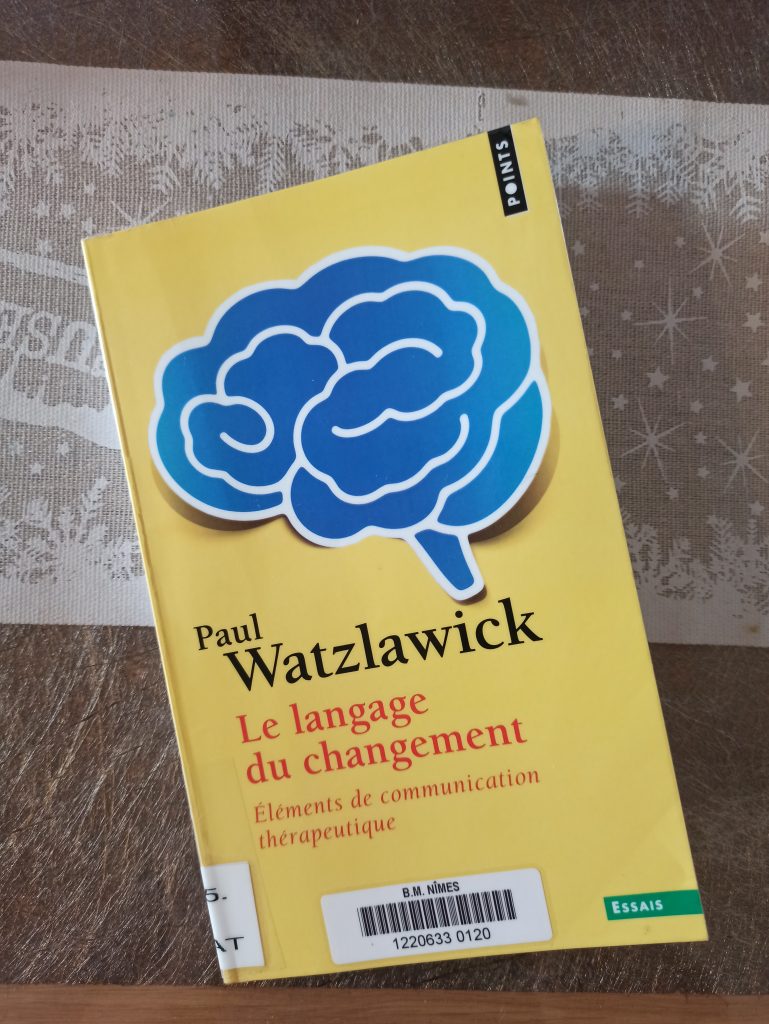
Le langage du changement.
Le langage thérapeutique était parfaitement connu des rhétoriciens de l’Antiquité, mais bien d’autres caractéristiques de ce langage ont fait l’objet d’études détaillées depuis fort longtemps, dans les domaines les plus divers de l’expérience humaine, qu’il s’agisse de l’enfance, de la formation du langage, de la fiction, des mots d’esprit, de l’extase, du délire et de la folie.
Mais tout ce qui émerge ainsi des royaumes que l’on attribue à l’inconscient, cette face cachée de l’âme, en raison de leurs inquiétantes étrangetés, est habituellement traduit au cours du dialogue clinique dans le langage censément thérapeutique de la raison et de la conscience.
Si l’on y réfléchit, il devrait apparaître évident que ce langage obscur et souvent singulier détient la clé naturelle de ces domaines qui seuls peuvent fournir le cadre d’un changement thérapeutique.
On peut débarrasser un enfant de ses verrues en lui achetant
De fait, on lui fait cadeau d’une pièce en échange de sa verrue que l’on est en droit d’exiger. En général, l’enfant, amusé ou déconcerté, demande comment il est censé pouvoir s’acquitter de son obligation, à quoi on lui répond nonchalamment qu’il n’a pas lieu de se tracasser, que la verrue partira toute seule.
Bien que nul n’ignore depuis des temps immémoriaux que toutes sortes de traitements magiques et superstitieux des verrues ont un effet thérapeutique réel, il existe aucune explication scientifique satisfaisante de ses guérisons.
On assiste là à un phénomène vraiment tout à fait extraordinaire : une interaction symbolique de nature totalement absurde provoque un résultat concret. Les vaisseaux sanguins qui irriguent les tissus d’origine virale se contractent, et la verrue, en état d’anoxie, finit par s’atrophier.
Ceci signifie en tout cas que certaines communications interpersonnelles ont l’effet de modifier l’humeur, les opinions ou les sentiments, comme nous pouvons le constater tous les jours, mais qu’elles peuvent être également à la source d’un changement physique qui, normalement, ne peut pas être produit délibérément.
Par ailleurs, nous savons tous trop bien que nos émotions peuvent nous rendre bel et bien malades, que nous pouvons obtenir le même résultat par autosuggestion, tout en ignorant, pour ainsi dire, que cette prose pathogène, nous l’avons toujours maniée quand nous communiquons avec nous-même.
Mais ceci revient à dire ni plus ni moins que, si l’on admet que l’on peut guérir le mal par le mal, il doit être possible de mettre cette même prose au service de la guérison. Ou pour l’exprimer de façon quelque peu différente : on peut trouver d’innombrables exemples de l’effet néfaste ou bénéfique des émotions, des fantaisies, et surtout de l’influence que les hommes peuvent exercer sur leur semblables.
Nul n’est besoin d’insister sur des cas aussi exotiques que les effets bien concrets de malédiction rituel, le phénomène de la mort-vaudou, la réalisation effective de certaines malédictions ou les succès souvent incroyables de certains guérisseurs spirituels pour comprendre qu’il faut bien qu’il y ait un langage qui produise ces phénomènes.
Il est alors censé, au moins dans une certaine mesure, d’affirmer que ce langage peut faire l’objet d’une étude et d’un apprentissage. Beaucoup de référence à l’hypnose en particulier au travail de Milton Erickson sont faites tout au long de l’ouvrage.
Communication Thérapeutique
Antiphon d’Athène (480-411 av. JC) paraît être le plus ancien à se rapprocher de ce concept moderne de communication thérapeutique.
Nous ne savons que peu de choses de l’homme et de sa vie, et nous ne sommes même pas sûr que le sophiste et le guérisseur était une seule et même personne.
Mais si l’on en croit certaines notations fragmentaires, Antiphon était l’inventeur d’un art de l’apaisement et il pensait qu’il serait peut-être possible d’arriver à intégrer les phénomènes de la persuasion et les autres cas d’influence verbale dans un cadre théorique satisfaisant.
Antiphon encourageait le patient à parler de ses souffrances et ensuite l’aider en utilisant une rhétorique qui reprenait à la fois le style et le contenu des propos du malade.
Il procédait à ce qui dans un sens très moderne revient à un recadrage de ce que le malade considéré comme réel ou vrai et modifiait ainsi son image pathogène du monde.
Plutarque écrit d’Antiphon : tout en poursuivant ses activités de poètes, il inventa un art d’apaisement de la douleur, tout comme existe des traitements médicaux pour ceux qui sont malades. On lui donna une maison à Corinthe près de l’Agora, qu’il orna d’une enseigne qui annonçait qu’il avait le pouvoir de guérir les malades avec les mots.
Et c’est dans le même esprit que le Georgias de Platon fait l’éloge du pouvoir de la rhétorique : il m’est arrivé maintes fois d’accompagner mon frère Herodicus ou d’autres médecins chez un malade qui refusait toute drogue ou ne voulait pas se laisser traiter par le fer ou le feu. Et, là où les exhortations du médecin restaient vaines, moi je persuadais le malade par le seul art de la rhétorique.
Si l’éloquence peut jouer au point de déclencher en nous angoisse, colère et larmes pour des sujets que nous savons relever de la fiction ou de l’irréel, quelle force doit être la sienne quand nous croyons vraiment à ce que nous entendons ?
Pour ma part je n’hésite pas à affirmer qu’un discours médiocre, soutenu par l’éloquence dans toute sa puissance, et plus efficace que le meilleur des discours, privé de cette même puissance. Marcus Fabius Quintilianus
(Quintilianus : Rhéteur et pédagogue latin du Ier siècle apr. J.-C. Il est l’auteur d’un important manuel de rhétorique, l’Institution oratoire, dont l’influence sur l’art oratoire se prolongea pendant des siècles.)
Hémisphère gauche et hémisphère droit
Paul Watzlawick, avec les connaissances de son époque, notamment en s’appuyant de l’anatomiste Arthur L. Wigan (The duality of the mind) qui affirmait que le cerveau gauche et le cerveau droit forment, au point de vue de la pensée un tout organique distinct et complet en soi et qu’un processus séparé distinct de penser ou de raisonnement peut se poursuivre simultanément dans chaque hémisphère.
Partant de ce paradigme, reposant sur des preuve anatomique établi à partir d’examen post mortem*, l’auteur admet l’hypothèse que l’hémisphère gauche du cerveau est celui du découpage rationnel et analytique, le droit est celui de la saisie globale, poétique, figurative* : c’est donc là que se constitue, pour un sujet, son image du monde, cette mosaïque qui s’élabore à partir de myriade d’expérience, de conviction, d’influence et d’interprétation.
*Aujourd’hui, nous savons que cela est un réductionnisme que beaucoup qualifient de neuro-mythe et j’en fait partie.
La cognition repose sur le fonctionnement simultané des deux hémisphères : chaque individu utilise aussi bien son hémisphère droit que son hémisphère gauche. Opposer diamétralement les deux ne paraît donc pas pertinent du point de vue des connaissances scientifiques actuelles.
Néanmoins, de nombreuses preuves expérimentales et recherches de l’époque, Stuart J. Dimond (the double brain), Geschwind, Galin etc.. ont mis en lumière deux modalités, qui aujourd’hui sont certes plus complexes et reliées, mais qui à mon sens ne méritent pas de ne pas s’y pencher, non pas sur la véracité du discours au sens scientifique, mais davantage sur des phénomènes que nous pouvons tous constater à travers les images du monde et le réductionnisme dont nous faisons tous preuve.
On pourrait dire, en faisant appel à une doctrine aussi ancienne que le bouddhisme à ses débuts, qui, nous le savons était éminemment pragmatique, que ces sujets souffrent de leur image du monde, d’une contradiction non résolue entre le monde tel qu’il apparaît et le monde tel qu’il devrait être, d’après l’image qu’il s’en sont faites.
Il ne reste alors qu’une alternative : soit intervenir directement sur le cours des événements et faire en sorte que le monde s’approche de l’image qu’ils en ont, soit, quand le monde ne peut être changé, faire concorder leur image avec les faits concrets.
L’image du monde, la vision de ce qu’il “devrait” être, possède une existence bien réelle, comme l’illustre l’aphorisme souvent cité d’Epictète : “ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais l’opinion que nous nous en faisons.”
Nous sommes donc confrontés à deux réalités.
Nous pensons que l’une existe objectivement, hors de nous, de façon indépendante.
L’autre est le résultat de nos opinions et de notre jugement et constitue donc notre image de la première.
K. Jasper : “Quand nous parlons de la réalité ou que nous en souffrons, nous nous référons à un édifice dont seul le “Seigneur” serait en mesure de connaître les tenants et aboutissants ; nous avons oublié, si nous n’avons jamais su, que c’est nous qui sommes les architectes de cette édifice que nous ressentons maintenant comme extérieur, comme si c’était la vraie réalité, indépendante de nous.”
Nous devons donc considérer une image du monde comme la synthèse la plus vaste, la plus complexe que peut réaliser l’individu à partir des myriades d’expériences, de conviction, d’influence, d’interprétation et de leurs conséquences sur la valeur et la signification qu’il attribue aux objets perçus.
L’image du monde, c’est, au sens très concret et premier, le produit de la communication, comme j’ai déjà essayé de le montrer dans un ouvrage antérieur.
L’image du monde n’est pas le monde.
Elle consiste en une mosaïque d’image, interprétable différemment aujourd’hui ou demain, en une structure de structure, une interprétation d’interprétation, elle s’élabore au moyen de décision continuelle sur ce qu’il faut ou non inclure dans ces méta-interprétations qui découlent elles-mêmes de décision antérieures.
Changer la réalité subjective
Si l’on veut changer cette réalité apparemment inébranlable, il faut savoir d’abord ce qui doit changer (ce qui signifie qu’il faut connaître l’image du monde en question), et ensuite comment ce changement peut-être concrètement réalisé.
À partir de ces deux pôles du quoi et du comment, s’ensuit d’importantes conclusions concernant le langage et la technique de la psychothérapie.
En ce qui concerne la technique, on dénombre 3 démarches qui peuvent se présenter à des degrés divers et dans des combinaisons variées au cours de la pratique psychothérapeutique :
- l’emploi des structures linguistiques de l’hémisphère droit (autrement dit utiliser les images, aphorismes, les métaphores etc…)
- le blocage de l’hémisphère gauche (par des paradoxes, des confusions, des saturations…)
- la prescription de comportements spécifiques (prescription du symptôme, déplacement, recadrage, alternative illusoire…)
Les rituels thérapeutiques
L’un des maux dont souffre fondamentalement notre époque tient probablement à ce que, dans un accès d’hubris de notre “hémisphère gauche”, nous avons banni le rituel de notre vie.
Car, même si cette amputation semble s’être effectuée sans dommage, le désir immémorial que nous nourrissons à l’égard du mystère des rituels reste inassouvi, et contribue à créer en nous une impression aiguë d’absurdité et de vacuité des choses.
Certes il existe encore des rituels mais pour la plupart ils ont été vidés de tout contenu.
Les rituels ont été pour une bonne part relégués à la marginalité restreignant grandement la participation de “l’hémisphère droit”.
Conclusion
Le caractère peu orthodoxe des techniques que nous venons de présenter, et notamment leur logique si étrangère à la psychoseologie, provoque en général un scepticisme qui prend la forme des trois objections suivantes :
- Parmi l’écrasante multitude des interventions possibles, comment le thérapeute peut-il choisir dans chaque cas celle qui convient ? Étant donné que la solution constitue le problème, c’est donc elle seule qui doit déterminer la nature et la structure de l’intervention adéquate.
- La seconde objection porte sur la durée de l’amélioration consécutive à ces interventions.
Dans aucun autre domaine comparable des activités humaines, il n’est postulé ni admis comme tel que le changement doit être total et définitif.
Dans cette perspective, le but de la thérapie devient d’accéder à l’utopie d’un état exemple de souffrance ou de problème.
- La troisième objection concerne le caractère apparemment superficiel de notre démarche, laquelle contredit de façon si éclatante la conception qui veut que les problèmes humains soient profondément enracinés et que, pour cette raison, la résolution exige une étude en profondeur et de longues procédures.
Mais on ne peut pas déduire à priori du simple fait qu’une technique donnée ne s’insère pas dans le cadre conceptuel d’une autre théorie qu’elle soit fausse ou dépourvue d’utilité.
Au début de ce livre, j’ai dit que je voulais exposer une théorie simple, mais d’application “difficile”. L’application pratique reste bien le problème crucial, qu’il faut aborder autrement que dans cette vieille plaisanterie : “Jouer du piano, ça n’existe pas. J’ai essayé à plusieurs reprises et je n’y suis jamais arrivé.”
Sylvain Gammacurta