De la vérité et du mensonge au sens extra-moral, traduction par Dan Duchateau.
Écrit en 1873 et publié à son insu durant les abîmes de sa “folie”, ce texte fulgurant de Nietzsche dynamite les certitudes les mieux établies : il retourne les fondations de la vérité, met à nu l’illusion tapie dans le langage et révèle la fonction vitale du mensonge dans l’édifice humain.
Cette traduction, proposée par Dan Duchateau, diplômé d’un master en philosophie, ne se limite pas à transmettre le texte : elle en offre une lecture claire et vivante.
Commentaires affûtés, carte conceptuelle et surtout exercices pratiques transforment la lecture en une véritable expérience.
Ici, nous ne sommes pas dans étude froide et pompeuse, mais une immersion provocante, où l’univers nietzschéen cesse d’être un monument figé pour devenir un champ de forces qui nous traverse, nous dérange parfois et surtout nous réveille.
Ce court texte, longtemps méconnu, agit comme un acide jeté sur les fondations de la métaphysique occidentale : il n’y a pas de vérité absolue, seulement des illusions stabilisées. Reste à savoir : voulons-nous dormir dans le colombarium, ou apprendre à danser dans le vacillement des métaphores ?
L’auteur l’annonce lui-même dès les premières pages : “Je n’ai pas traduit Nietzche juste pour l’expliquer; cela, beaucoup d’autres l’ont déjà fait. Je l’ai traduit afin qu’il dérange à nouveau!”
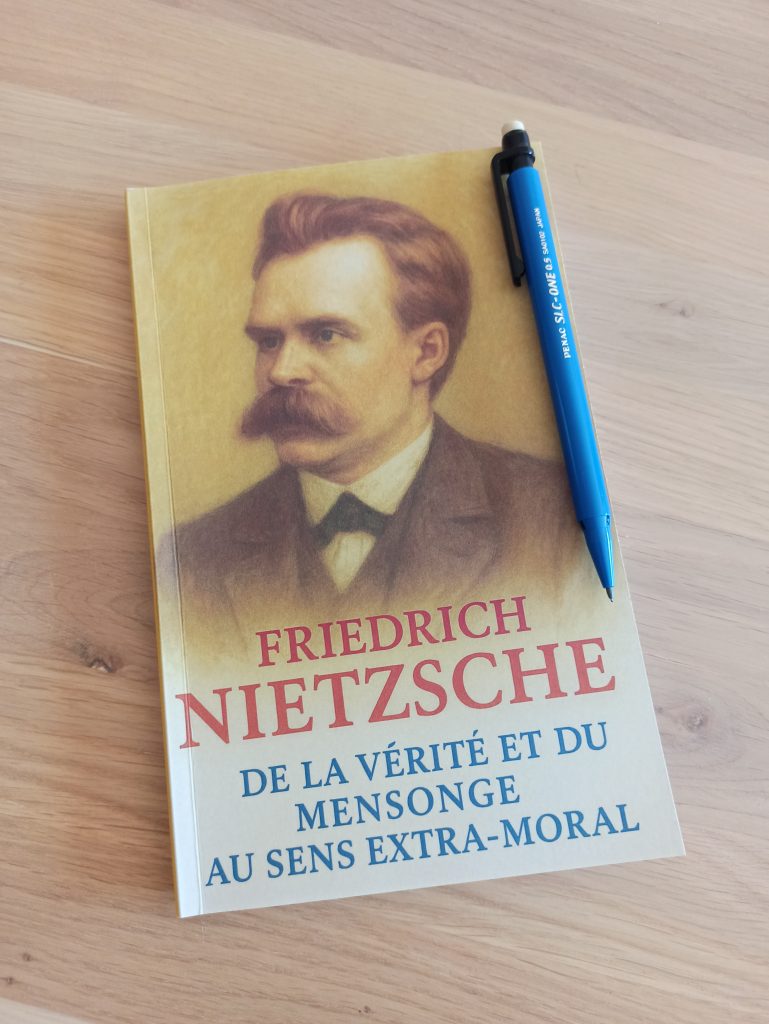
I. Une minute d’orgueil dans l’immensité cosmique
Au seuil de ce texte, Nietzsche déconstruit brutalement l’orgueil de l’intellect humain.Selon lui, il n’y a pas de mission cosmique confiée à l’homme pensant, mais seulement une anecdote minuscule dans l’histoire de l’univers.
L’invention de la connaissance “fut la minute la plus orgueilleuse et la plus mensongère du monde”.
Orgueilleuse, parce qu’elle fit croire à l’animal humain qu’il touchait à l’essence des choses ; mensongère, parce que dès le départ, ce geste ne fut qu’un stratagème vital, une ruse pour survivre, en somme un mécanisme purement adaptatif.
La vérité apparaît ici comme une illusion indispensable à la vie “des êtres les plus mal lotis, les plus délicats, les plus éphémères, afin de les retenir une minute dans l’existence”.
Mais Nietzsche va plus loin, il affirme que cette illusion n’est pas un voile accidentel, elle est la base même de notre expérience. La nature, dit-il, a “jeté la clé” : l’homme ne pourra jamais lever le voile de ses propres fables, car c’est par elles qu’il existe.
“Et malheur à la curiosité fatale qui viendrait un jour, par une fente, regarder hors de la chambre de la conscience, vers le bas et qui deviendrait alors que l’homme repose sur l’impitoyable, l’avidité, l’insatiable, le meurtrier, dans l’indifférence de son ignorance, suspendu comme en rêve sur le dos d’un tigre.”
Il faut prêter une attention particulière à cette qualification : “extra-moral”. Nietzsche ne parle pas de vérité et de mensonge au sens courant du terme, c’est-à-dire sous l’angle d’une éthique du devoir ou d’une morale de la sincérité. Il déplace radicalement les curseurs hors du champ de la morale, pour les situer sur un plan plus originel : celui des conditions mêmes de notre rapport au monde. En ce sens, dire que la vérité est “extra-morale”, c’est refuser de la juger selon les catégories de bien et de mal, et comprendre qu’elle relève d’une invention, d’un artifice vital pour l’être humain.
Ce terme exige donc du lecteur un effort de conversion : il ne s’agit pas de condamner le mensonge comme faute, ni de célébrer la vérité comme vertu, mais de les envisager comme des formes d’illusion stabilisée, des manières de survivre, de se protéger, d’habiter le monde.
L’”extra-moral” rappelle que Nietzsche ne cherche pas à moraliser le langage, mais à en dévoiler la puissance créatrice et le caractère foncièrement perspectif.
« La moralité, c’est l’instinct du troupeau chez l’individu. » – Nietzsche §116 du troisième livre du Gai Savoir
L’image est brutale mais limpide. Elle signifie que ce que nous appelons “morale” n’est pas le fruit d’un choix libre et éclairé, mais l’intériorisation de règles imposées par le groupe pour sa propre survie. Être moral, dans ce sens, ce n’est pas choisir, mais répéter ce que la communauté a décrété de “vrai”, de bon ou mauvais, souvent par simple habitude, par peur d’être exclu, ou par confort de ne pas avoir à inventer sa propre mesure.
Selon lui d’ailleurs, la morale sert à orienter et à contraindre l’individu à se conformer à des normes qui ne correspondent pas nécessairement à ses propres valeurs ni à ses convictions intimes. Il affirme que la morale sert bien souvent à légitimer des conduites oppressives et à satisfaire des pulsions de cruauté ou de vengeance, plutôt qu’à œuvrer réellement pour le bien commun.
II. La dissimulation comme origine du langage et de la vérité
“L’intellect, en tant qu’il est moyen de conservation de l’individu, déploie ses forces principales dans la dissimulation…”
Dissimuler, flatter, tromper, voilà la fonction première de l’esprit ; l’homme en est le sommet.
Le point décisif du texte réside dans l’identification du langage au mensonge. Tout mot est métaphore, traduction infidèle, déplacement. Le paradoxe est radical : il n’y a pas, derrière le langage figuratif, un langage littéral, pur, transparent. Toute nomination est déjà une falsification, une substitution arbitraire.
De ce point de vue, toutes quêtes de vérité devrait se savoir provisoire, symbolique, pluriel et humble. Dès qu’elle prétend coïncider avec le réel lui-même, elle devient ridicule. Et chaque fois que nous forçons sa bouche à prononcer un discours définitif, nous produisons de l’idéologie, c’est-à-dire une parole humaine travestie en parole du monde.
“Ce n’est que grâce à l’oubli que l’homme peut en venir à croire qu’il possède une “vérité”.”
Article relatif : Le Silence de la Joie
“Qu’est-ce qu’un mot ? L’image sonore d’une excitation nerveuse. Mais conclure de cette excitation nerveuse à une cause extérieure à nous c’est déjà le résultat d’une application fausse et injustifiée du principe de causalité.”p.21
Ce que nous appelons “vérité” naît selon Nietzsche d’un accord de troupeau, d’une convention pratique qui permet à la vie sociale d’exister et de se maintenir. Ainsi, la vérité n’est qu’un mensonge stabilisé, un masque devenu obligatoire. L’erreur n’est punie qu’en raison des dommages qu’elle entraîne. L’homme ne désire donc la vérité que dans un sens limité, pour ses effets agréables et favorables à la vie, restant souvent indifférent à une connaissance pure et hostile aux vérités nuisibles ou destructrices.
Les mots, selon Nietzsche, révèlent plutôt l’audace de nos projections et la préférence unilatérale pour certaines propriétés. Nous isolons arbitrairement une propriété (la dureté, la fluidité, le tortillement, la couleur…) et l’érigeons en essence. La matière sur laquelle l’homme de vérité, le chercheur, le philosophe, travaille et construit ne provient pas de la nature des choses en soi, mais au mieux de son propre château en Espagne.
Pour Nietzsche le langage est toujours déjà convention, et donc toujours déjà fiction.
III. Homme raisonnable VS homme intuitif
L’être humain oublie souvent que ce qu’il appelle “vérité” n’est en réalité qu’une manière de voir le monde, une habitude de pensée. Et c’est justement cet oubli qui lui donne l’illusion que sa vérité est solide et universelle.
En cherchant à être “raisonnable”, il range ses expériences vivantes dans des cases abstraites, il transforme des impressions riches et singulières en concepts froids et figés. Au fil du temps, ce qui n’était au départ qu’une image ou une comparaison devient accepté comme une vérité dite “objective”.
Quand nous disons par exemple : « le chameau est un mammifère », ce n’est pas la nature qui apprend quelque chose, le chameau, lui, n’a pas besoin de cette définition. C’est seulement nous qui nous rassurons en classant, en ordonnant, en découpant le réel selon nos catégories. Nous façonnons ainsi le monde à notre image, en le mesurant sans cesse à l’échelle humaine.
Merleau-Ponty, un siècle plus tard, reprend cette idée mais la déplace. Dans “Phénoménologie de la perception” puis “Le visible et l’invisible”, il montre que le langage, qui pour lui est loin d’être seulement un voile ou une falsification, est d’abord un geste incarné, enraciné dans le corps et dans l’expérience perceptive. En ce sens, nommer, c’est moins imposer une grille arbitraire que chercher à faire résonner, à rendre visible une expérience toujours excédentaire.
Là où Nietzsche insiste sur la trahison du réel par le concept, Merleau-Ponty nuance et insiste sur l’ouverture qu’offre le langage : il ne capture certes jamais totalement l’expérience, mais il la fait advenir dans une forme partageable.
La radicalité du texte tient au fait que Nietzsche assume jusqu’au bout le paradoxe qu’il expose. Si tout langage est mensonge, alors son propre discours sur le langage devrait lui-même se dissoudre dans ce même mensonge. C’est là qu’intervient la singularité de Nietzsche : au lieu de chercher une sortie vers une vérité ultime il accepte d’exposer sa philosophie à ce vertige.
Il ne s’agit plus seulement de douter de ce que je perçois, mais de douter de la valeur même des mots par lesquels je pense ce doute.
Nietzsche nous conduit ainsi à un vertige : si nos vérités ne sont que des illusions devenues habituelles, alors comment vivre dans ce monde fait de fictions et de métaphores figées ?
Deux attitudes sont alors possibles selon lui :
- Nous pouvons chercher refuge dans la raison, en ordonnant le chaos pour le rendre supportable.
- Ou bien nous pouvons nous laisser emporter par le jeu des images et des intuitions, au risque d’y trouver autant de lumière que de tourments.
D’un côté, il y a l’homme raisonnable. Il cherche avant tout la sécurité. Pour lui, mieux vaut prévoir, rester prudent, organiser sa vie selon des règles claires. Son but est simple : éviter autant que possible la souffrance et les mauvaises surprises. Mais cette prudence a un prix : elle n’apporte pas la joie véritable, seulement une forme de protection. Et quand vient le malheur, il se cache derrière un masque de force tranquille.
De l’autre côté, il y a l’homme intuitif. Il vit dans un monde vibrant d’images et de métaphores. Son imagination colore tout ce qu’il touche, la vie lui apparaît comme une fête, riche, imprévisible, pleine de dieux et de merveilles comme dans les récits des Grecs anciens. Cette façon d’exister lui donne une lumière intérieure, une clarté joyeuse, presque une délivrance. Mais là encore, il y a un revers : lorsqu’il souffre, il souffre beaucoup plus fort. Et souvent, il ne tire pas de leçons de ses épreuves, retombant dans les mêmes pièges. Ainsi, la vie des peuples qui vivaient dans les mythes ressemblait plus à un rêve éveillé qu’à la vie rationnelle des modernes désenchantés par la science. Car l’être humain a en lui un penchant profond : celui d’aimer être trompé, ou plutôt enchanté, par les images et les histoires. Et l’intelligence, quand elle échappe à son rôle d’outil pratique, se plaît parfois à inventer librement, à briser les barrières trop rigides, célébrant une fête de métaphores et de visions.
Bergson, dans L’Évolution créatrice, dénonce un phénomène analogue : l’intelligence humaine est adaptative mais réductrice. L’intellect, dit-il, est fait pour découper, classer et prévoir, exactement comme Nietzsche décrit l’homme raisonnable. Mais la vie, dans sa durée, paraît être flux et continuité, elle ne se laisse jamais enfermer dans des catégories fixes. L’intuition, pour Bergson, est l’outil permettant d’atteindre cette durée, de ressentir la vie comme elle est, en perpétuel devenir, et non comme une série de concepts abstraits.
“Il y a des époques où l’homme raisonnable et l’homme intuitif se tiennent côte à côte : l’un dans la crainte de l’intuition, l’autre dans le mépris de l’abstraction. L’un est aussi peu artiste que l’autre est peu raisonnable. Tous deux veulent dominer la vie : le premier en affrontant ses principales nécessités par la prévoyance, la prudence, la régularité ; le second tel un héros enivré de joie ne voyant pas ces nécessités et ne prenant pour réel que la vie travestie en apparence et en beauté.”
Cette dichotomie résonne puissamment avec la typologie kierkegaardienne du désespoir :
Pour Kierkegaard, le désespoir est d’abord le mal du moi, une impossibilité de s’approprier pleinement son existence. Il distingue plusieurs formes : le désespoir involontaire (ne pas se connaître soi-même), le désespoir conscient (refuser de s’accepter tel qu’on est), et le désespoir radical (refuser Dieu, l’ultime relation de soi à soi).
- On peut lire l’homme raisonnable de Nietzsche comme une figure du désespoir de conformité : il s’enferme dans la prudence, l’ordre et la régularité pour éviter le malheur, mais cette maîtrise apparente le prive de devenir pleinement soi. Kierkegaard dirait que ce type d’homme vit dans un désespoir masqué : il croit se protéger, mais il s’ignore lui-même, et reste prisonnier d’un moi partiel, superficiel.
- L’homme intuitif correspond davantage au désespoir de l’excès : il refuse la limitation, vit intensément, se laisse emporter par la beauté et l’apparence. Mais Kierkegaard montre que ce plaisir désordonné peut lui aussi être une forme de désespoir. En fuyant les nécessités réelles de l’existence, il ne se réalise pas, et se condamne à retomber sans cesse dans le manque de soi.
Article associé : La Maladie à la mort de Kierkegaard
C’est précisément là que Nietzsche renverse à mon sens la perspective. Si l’homme aime être trompé, ce n’est pas par faiblesse ou désespoir mais simplement parce que l’illusion est constitutive de son rapport au monde. Plutôt que de rêver une vérité pure, il vit et crée à travers des images, des fictions, des récits. La science elle-même n’échappe pas à ce mouvement : elle n’est qu’une forme plus austère de ce besoin d’inventer.
C’est pourquoi Vérité et Mensonge au sens extra-moral ne livre pas un nouveau fondement, mais un geste de déconstruction généralisée : tout discours philosophique est lui-même rhétorique, figural, métaphorique. Mais cet effondrement n’ouvre pas sur un nihilisme.
Car si la vérité n’est qu’une illusion stabilisée, il reste à la transformer en jeu : l’art, le mythe, la poésie deviennent les lieux où l’illusion se sait illusion, où le langage brise ses propres chaînes et se recrée sans cesse.
Conclusion et perspectives personnel
En définitive, Vérité et mensonge au sens extra-moral ne se contente pas de saper la prétention de la raison à accéder à un fondement ultime. Nietzsche y met au jour la nature foncièrement rhétorique et créatrice du langage. L’illusion n’est pas un accident dont l’homme pourrait se débarrasser, mais l’élément vital dans lequel il respire et évolue. Loin de mener à un scepticisme stérile, ce constat ouvre à une réhabilitation de l’art, du mythe et de la poésie comme lieux privilégiés où l’illusion se sait telle et se joue librement d’elle-même. Le philosophe ne peut donc plus se poser en gardien d’une vérité intemporelle, mais en bâtisseur de métaphores, conscient de leur fragilité comme de leur puissance.
Camus, un siècle plus tard, reprend ce fil mais le déplace en utilisant le concept de l’absurde. L’absurde, pour lui, ne réside pas dans l’illusion linguistique mais dans la confrontation entre deux forces irréconciliables : le désir humain de clarté, de raison, de vérité, et le silence du monde, qui n’offre ni réponse, ni sens préétabli.
Là où Nietzsche montre que nos vérités sont des fictions stabilisées, Camus affirme que le problème n’est pas seulement que nos vérités soient fragiles, mais que le monde, lui, reste muet face à notre demande de cohérence.
Ce lien est selon moi fécond : on pourrait dire que Nietzsche prépare l’absurde camusien. En dévoilant la nature illusoire et rhétorique de nos vérités, il ouvre déjà la voie à une pensée où l’homme doit vivre sans appui transcendant. Mais là où Nietzsche invite à transformer ce constat en une fête créatrice. D’ailleurs, quand Nietzsche déclare cette phrase célèbre que « Dieu est mort », il ne décrit pas la disparition d’un être divin, mais l’effondrement d’un monde de sens : celui où la vérité, la morale et les valeurs trouvaient leur fondement dans une transcendance. Avec la critique moderne, la science et la sécularisation, cette garantie s’est dissoute. Ce constat libère l’homme de toute tutelle religieuse, mais il l’expose aussi au vertige : si Dieu ne fonde plus le vrai et le bien, tout semble vide et sans but. Pour Nietzsche, le défi n’est pas de se résigner, mais de créer de nouvelles valeurs à la mesure de la vie elle-même : assumer la liberté radicale et inventer un sens sans recours à l’arrière-monde.
Entre l’ascétisme du rationnel et l’extase de l’intuitif, l’humanité oscille ; mais sous chaque masque, c’est toujours l’instinct poétique qui travaille, tissant sans fin de nouvelles illusions pour rendre la vie supportable et, parfois, splendide.
L’art, pour Camus comme pour Nietzsche, garde un rôle central : non comme accès au vrai, mais davantage comme manière de témoigner de cette fracture, de lui donner forme sensible, d’habiter l’absence de fondement sans la nier.
À la lecture de ce livre, j’ai été frappé par la manière dont Nietzsche met en évidence le rôle créateur et médiateur du langage dans notre rapport au réel. Ces idées ont trouvé un écho direct dans ma pratique et mes réflexions d’hypnologue. Lors des exercices pratiques proposés par Dan Duchateau en fin d’ouvrage, j’ai pu expérimenter concrètement ce que Nietzsche évoque de façon philosophique : la parole ne se contente pas de transmettre des concepts, elle façonne l’expérience vécue, transforme la perception du corps et du monde, et révèle la plasticité de notre conscience.
Ces liens se sont faits naturellement dans mon esprit avec les travaux de François Roustang et le constructivisme de Paul Watzlawick.
À l’instar de Roustang, j’ai pu constater que l’hypnose n’est pas une simple technique, mais un espace où la parole permet de réinterpréter le vécu, d’inventer des ressources et de libérer la créativité du sujet. Et, comme Watzlawick l’a souligné, la réalité n’est jamais brute : elle se construit à travers les récits et les interactions.
L’hypnose telle que je la pratique, illustre ce principe de façon tangible, en montrant comment les croyances, les mots et les attentes peuvent transformer profondément la conscience.
Article associé : Hypnose, hypnologie, philosophie et stratégies
Ainsi, pour moi, la lecture de ce livre et la mise en pratique de ses exercices ont été une confirmation et une expansion de ce que j’observe dans mon travail : la « vérité » de notre vécu n’existe jamais indépendamment des récits et des images par lesquels nous le construisons. L’hypnose apparaît alors comme une prolongation concrète de l’intuition nietzschéenne, un terrain où l’expérience humaine se réinvente et se révèle dans toute sa richesse.
Je tiens à remercier sincèrement Dan Duchateau pour la qualité de son travail et pour m’avoir autorisé à écrire sur ces réflexions et à les joindre à la mienne. Ce livre ne m’a pas seulement nourri sur le plan intellectuel : il a approfondi ma pratique, affiné ma modeste compréhension de Nietzsche, et surtout rappelé la puissance créatrice du langage qui occupe une place centrale dans mon travail.
Un mot du traducteur
Dans notre échange, Dan Duchateau confie ce qui l’a marqué au plus vif de cette entreprise :
“Ce qui résonne pour moi dans cet ouvrage, c’est que Nietzsche montre que la vérité est tout sauf une évidence ! Elle est une invention humaine toujours en mouvement, jamais fixe ; son apparente solidité n’est qu’affaire d’habitude et d’incorporation, non d’essence absolue. Ce texte agit comme une piqûre de rappel, une mise en garde : il faut se méfier de ce qui se présente comme certain et définitif.”
Traduire Nietzsche, ajoute-t-il, a été une expérience exigeante mais doublement féconde.
“D’abord, la discipline : chercher à restituer le style vif, ironique, provocateur de Nietzsche, son rythme, sa mélodie, cela a demandé un travail de fond et de forme considérable. Ensuite, une leçon existentielle : plonger dans ce texte m’a appris à penser plus librement, à jouer avec les mots et avec la richesse de leurs sens.”
Vous procurer ce livre : De la vérité et du mensonge au sens extra-moral: Traduction inédite enrichie – Commentaires, cartes conceptuelles, exercices
Instagram de l’auteur : https://www.instagram.com/dan.duchateau/
Sylvain Gammacurta
