Søren Kierkegaard, penseur danois du 19e siècle, est pour moi une figure centrale de la philosophie de la foi, de la conscience de l’absolu . Dans La Maladie à la mort (1849), il explore le désespoir, non comme une simple douleur, mais comme une condition profonde de l’âme humaine. Ce texte majeur, sous le pseudonyme d’Anti-Climacus, met en lumière la lutte intérieure du sujet et appelle à un saut existentiel vers la foi.
L’article qui suit invite à découvrir les clés de cette œuvre essentielle, mêlant philosophie, théologie et psychologie.
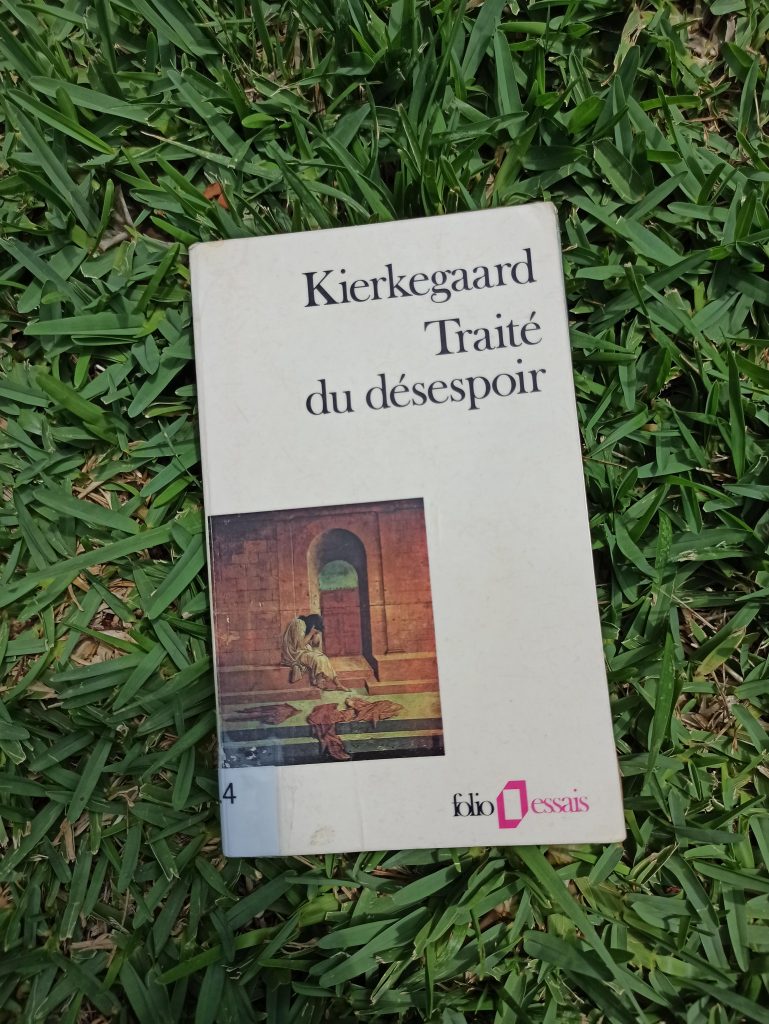
Je ne prétends ici transmettre qu’un éclairage partiel, forgé à l’épreuve d’une lecture aussi bouleversante qu’ardu. Ce que j’offre dans ces pages, c’est une tentative sincère, avec ses limites et ses tremblements, de dire ce que cette œuvre m’a donné à penser, à sentir, à traverser. Non un savoir, mais une rencontre.
I. Le désespoir : condition ontologique et dialectique de la connaissance de soi
Chez Kierkegaard, le désespoir ne se réduit ni à une simple blessure ni à une pathologie à éliminer au plus vite. Il est, au contraire, la condition même de la connaissance authentique de soi. Il s’agit d’un mal profond qui révèle la nature dialectique de l’existence humaine : être capable de désespérer, c’est déjà témoigner d’une conscience aiguë de soi, de cette tension entre ce que nous sommes et ce que nous pourrions être. Kierkegaard s’interroge d’ailleurs : le désespoir est-il un fardeau insoutenable, ou bien l’avantage majeur de notre humanité ? La réponse n’est jamais tranchée, car le désespoir incarne l’oscillation même de l’homme entre la chute et l’élévation. Ce qui est certain, c’est que cette expérience douloureuse ouvre la porte au « saut de la foi », ce mouvement existentiel fondamental qui permet au sujet de se réconcilier avec son être profond. En ce sens, être passible de désespoir, souffrir de cette fracture intérieure est, selon l’auteur, un privilège paradoxal, un signe éminent de la liberté et de la grandeur humaine. Autrement dit, le seul point de passage entre le possible et le réel, c’est moi, c’est ma décision. La décision n’est jamais le résultat d’un calcul, elle ne peut être qu’un engagement.
Pour Kierkegaard, le moi n’est pas une substance fixe mais un projet relationnel, une synthèse dialectique entre l’infini et le fini, l’éternel et le temporel, le passif et l’actif. Le désespoir apparaît lorsque ce rapport fondamental est défaillant, lorsque le moi ne parvient pas à s’accepter et à s’aimer dans son propre être, ni à se reposer dans la relation avec Dieu.
Kierkegaard décrit plusieurs formes de ce désespoir, qui permettent de comprendre la complexité de la condition humaine :
- Le désespoir inconscient : celui qui ne sait pas qu’il désespère. Le sujet vit dans l’illusion d’une vie comblée, généralement dans le divertissement, sans conscience de sa véritable essence.
- Le désespoir conscient, mais sans reconnaissance de soi-même : ici, le sujet sent sa division intérieure, son insuffisance, mais refuse encore de s’en remettre à Dieu, ou d’accepter sa condition.
- Le désespoir actif ou passif : le désespoir peut prendre la forme d’une révolte, d’un « défi » contre l’ordre divin, ou celle d’un renoncement, d’un abandon à la faiblesse et à l’impuissance.
Chacune de ces formes témoigne d’une incapacité à assumer pleinement le moi et Dieu.
Découvrez cet autre article : Carl Rogers – Le « Développement de la personne »
II. Dissimulations et hermétisme : le voile sur la maladie
Le désespoir, pour Kierkegaard, est une maladie cachée, hermétique. Il ne se montre pas d’emblée, il se dissimule à l’âme même qui en souffre. Cette dissimulation est une ruse de l’esprit : l’individu vit souvent dans l’illusion d’un moi unifié, complet, alors qu’en réalité il est divisé, disjoint de lui-même. L’hermétisme de cette maladie tient à ce qu’elle reste invisible jusqu’à ce qu’elle s’aggrave, comme un poison lent qui ronge la vie intérieure. Kierkegaard souligne que cette opacité est le signe même de la gravité du mal : car la vérité sur soi est toujours difficile à affronter. Le désespoir se dérobe aux lumières de la conscience, se refuse à la rationalisation simple, et s’enferme dans un secret qui isole davantage le sujet, aggravant sa solitude existentielle.
« Ce désespoir, d’un degré plus profond que le précédent, est de ceux qu’on rencontre moins souvent dans le monde. Cette porte condamnée, derrière laquelle il n’y avait que le néant, est ici une vraie porte, mais d’ailleurs verrouillée, et, derrière elle, le moi, comme attentif à lui-même, s’occupe et trompe le temps à refuser d’être lui-même, quoique l’étant assez pour s’aimer. C’est ce qu’on appelle l’hermétisme, dont nous allons nous occuper maintenant, ce contraire du spontané pur, qu’il méprise pour faiblesse intellectuelle. »
III. Le désespoir, véritable péché ontologique
« Maladie de l’esprit, du moi, le désespoir peut ainsi prendre trois figures : le désespéré inconscient d’avoir un moi (ce qui n’est
pas du véritable désespoir); le désespéré qui ne veut pas être lui-même et celui qui veut l’être. »
Dans une relecture radicale de la notion chrétienne de péché, Kierkegaard ne voit pas dans le péché un simple manquement moral ni un acte isolé, mais la condition même du désespoir, cette séparation fondamentale de l’homme d’avec lui-même et, par voie de conséquence, d’avec Dieu. Le péché est le refus de devenir ce que l’on est appelé à être, la négation de l’unité du soi, ce hiatus qui brise la cohérence de l’existence. C’est donc le désespoir lui-même qui constitue le péché suprême, car il empêche le sujet d’accéder à la vérité la plus intime de son être. En cela, Kierkegaard retourne la théologie traditionnelle : ce n’est pas la faute extérieure, observable, mais la fracture intérieure et silencieuse qui est la racine de toute déchéance spirituelle.
Dès lors, l’individu doit choisir : ou bien croire, par un saut existentiel, ou bien se scandaliser, c’est-à-dire se révolter intérieurement contre cette absurdité apparente. Le scandale, c’est l’orgueil de la raison et du moi, qui ne supportent pas l’humilité de la révélation chrétienne. Le scandale révèle ainsi le désespoir de l’homme : son refus d’être sauvé autrement que par ses propres forces, son incapacité à accepter un salut qui le dépouille de sa grandeur imaginaire. En ce sens, l’auteur en conclue que l’homme ne peut faire face car il est incapable d’un tel engagement, il ne peut alors que désespérer de lui-même.
Et quand bien même, l’homme adhère à Dieu, à l’absolue, cette foi salvatrice, l‘acte de foi ne nous contente jamais « intellectuellement ».
IV. L’imaginaire infini et le manque de nécessité : l’égarement dans le possible
« Le moi est liberté. Mais la liberté est la dialectique des deux catégories du possible et du nécessaire. »
Kierkegaard met en lumière la tension entre le fini et l’infini qui habite l’homme. Le désespoir naît du fait que le moi est jeté dans un monde de possibilités illimitées « l’imaginaire infini » sans être pour autant ancré dans une nécessité véritable, ce qui crée un vide existentiel. L’homme, égaré dans l’immense champ du possible, se perd dans ses projections, ses rêves, ses illusions, sans trouver d’assise réelle. Cette absence de nécessité, ce qui est nécessaire, certain, inéluctable , engendre un manque fondamental : le sentiment de ne pas être pleinement soi, d’être en suspens entre des horizons inaccessibles. Ce manque de fondement est au cœur de la maladie du désespoir, car il empêche le moi de s’ancrer dans une synthèse vraie entre fini et infini, entre temporalité et éternité.
« On mène alors une existence imaginaire en s’infinisant ou en s’isolant dans l’abstrait, toujours privé de son moi, dont on ne réussit qu’à s’éloigner davantage. »
Ce qui manque au fond c’est la force d’obéir, de se soumettre à la nécessité incluse en notre moi, à ce qu’on peut appeler nos frontières intérieures. (…) Un moi qui se regarde dans son propre possible n’est guère qu’à demi vrai ; car, dans ce possible-là, il est bien loin encore d’être lui-même, ou ne l’est qu’à moitié.
Pour Kierkegaard, l’homme ne souffre pas seulement d’un excès de possibles, mais aussi d’un manque de possible véritable. Il se trouve prisonnier d’une liberté illusoire où les choix restent indéterminés, sans nécessité ni véritable ancrage. Ce vide du possible authentique engendre un désespoir profond, car l’individu ne parvient pas à se réaliser pleinement ni à incarner son être véritable.
Le saut de la foi apparaît alors comme la condition nécessaire pour dépasser cette impuissance, en transformant l’indéfini en engagement concret et porteur de sens.
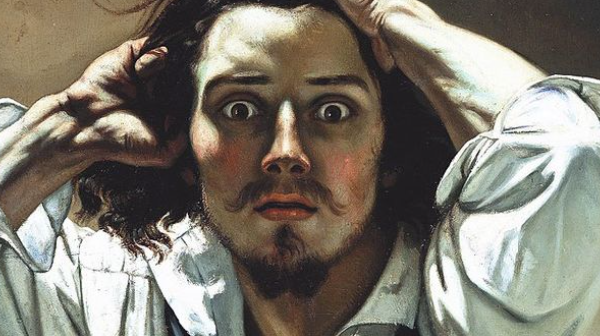
V. L’importance cruciale de se sentir désespéré
Kierkegaard expose dans La Maladie à la mort une anthropologie du désespoir, qu’il considère comme une condition universelle de l’homme. Pour lui et de manière très résumé, l’être humain est une synthèse de trois dimensions : le fini (le corps, les sens, le savoir), l’infini (l’imaginaire, la foi, les paradoxes), et la relation consciente qui les unit.
Cette synthèse est instable, toujours en tension. Lorsque l’équilibre se rompt, par excès de rationalité, d’imaginaire ou d’insensibilité, l’individu tombe dans le désespoir. Ce dernier n’est pas un simple symptôme, mais la véritable maladie du moi, enracinée dans la mauvaise relation à soi-même.
Pour Kierkegaard, il vaut mieux être conscient de son désespoir que d’en ignorer l’existence. Le désespoir inconscient, celui qui se voile à lui-même sa propre division, est plus grave encore que le désespoir lucide. La prise de conscience est la première étape de la guérison possible, car elle ouvre la voie à la reconnaissance de soi et donc au choix authentique. Celui qui ignore son désespoir reste prisonnier de l’illusion et de la fausse unité du moi, tandis que celui qui se sent désespéré peut commencer à se confronter à sa condition, et peut-être, par un effort existentiel, amorcer le saut décisif.
Pour Kierkegaard, le désespoir est la première attitude de la subjectivité humaine devant le mal, une attitude qu’il appelle « esthétique ». Pour faire simple, il distingue trois stades dans la vie humaine : le stade esthétique, le stade éthique et le stade religieux.
Le stade esthétique : L’existence comme évitement
C’est selon l’auteur, le stade de l’immédiateté et du plaisir, de la fuite de soi dans les expériences multiples : beauté, art, séduction, ironie, jeux de langage… Ce n’est pas simplement l’hédonisme brut, il peut y avoir un esthétisme raffiné, cultivé, mais ce qui caractérise ce stade, c’est l’esquive. L’individu esthétique refuse de s’engager pleinement, il refuse la responsabilité de son existence. Il vit dans une sorte d’ironie ou de mélancolie. Il cultive le paradoxe, mais ne s’y engage jamais. Il est « intéressé par tout et attaché à rien ». Il ne veut pas devenir lui-même, il veut se distraire de lui-même.
Mais ce stade mène à une impasse : le désespoir. Tôt ou tard, l’esthète éprouve un vide. L’ironie devient cynisme, l’amusement devient angoisse. Il est tenté par le renoncement intérieur. C’est ici que le saut vers l’éthique devient possible.
Le stade éthique : L’existence comme devenir soi
Le stade éthique représente une prise de conscience : celle de la responsabilité de son existence. L’individu cesse de fuir, il accepte de se rapporter à soi-même comme devoir. Il entre dans un processus de formation de soi, de fidélité à une vocation intérieure.
« Le moi est une relation qui, en se rapportant à soi-même, se rapporte à l’absolu. »
Dans ce stade, l’homme devient un soi en devenir, un projet éthique. Il cherche à réconcilier liberté et devoir, à vivre selon des principes universels (comme le mariage, la fidélité, le travail), mais ces principes sont incarnés dans l’expérience singulière d’un sujet. L’éthique, ici, n’est pas une morale extérieure, mais un engagement intérieur et libre.
C’est le domaine du choix véritable. Kierkegaard insiste : ce n’est pas la vie qui fait le choix, c’est le choix qui fait la vie. En choisissant éthiquement, je ne choisis pas tel ou tel objet, je choisis moi-même.
Mais là encore, il y a une limite. L’éthique ne peut pas sauver le moi. En effet, même la plus sincère tentative de vivre moralement se heurte à la culpabilité, au péché, à la finitude. C’est ici qu’émerge l’exigence d’un au-delà de l’éthique.
Le stade religieux : l’existence devant Dieu
Le stade religieux est celui de l’intériorité absolue, où l’individu reconnaît qu’il ne peut pas, par ses propres forces, se constituer comme soi. Le péché n’est pas une simple faute morale ; c’est le désespoir de ne pas pouvoir être soi sans Dieu.
Ce stade se divise parfois en deux :
Religieux A : forme universelle et philosophique, où l’homme se reconnaît comme un être fini devant l’infini, et cherche un apaisement (ex. : Socrate ou certains mystiques stoïciens).
Religieux B : proprement chrétien, où l’homme accepte le paradoxe de l’incarnation : Dieu s’est fait homme, dans le Christ, et c’est dans la relation personnelle avec Dieu que le soi se fonde.
« Le moi est un rapport qui doit être fondé par Dieu. »
A ce stade de mon cheminement personnel , je me reconnais davantage dans la position du religieux A : celle d’une conscience finie ouverte à l’Absolu, sans pour autant parvenir à franchir le paradoxe de l’Incarnation qui constitue le cœur du religieux B. En ce sens, je ne suis pas agnostique quant à Dieu, que je conçois comme une possibilité intelligible et peut-être même nécessaire. Mais je suis agnostique quant à l’incarnation de Dieu, c’est-à-dire quant à l’identification historique du divin à un homme particulier. Cette suspension n’est pas un refus, elle marque ma difficulté à poser comme acte de foi l’identification d’un être singulier au Dieu absolu. Le saut de la foi chrétienne, tel que Kierkegaard l’exige, suppose une rupture avec toute médiation rationnelle : il engage l’individu dans un choix déchirant, paradoxal, où l’évidence même devient scandale. C’est cette radicalité qui me retient autant qu’elle m’intrigue.
Le stade religieux B me fascine — non parce qu’il apporterait des certitudes, mais parce qu’il radicalise l’idée de relation personnelle avec Dieu, au point de la faire passer par l’absurde, par l’impossible à croire. En cela, je le perçois comme une épreuve qui appelle un acte existentiel décisif, que je ne me sens ni prêt ni légitimé à accomplir.
Cette position n’est pas de neutralité : elle est tension et appel.
Dans ce stade, le croyant réalise un saut (le célèbre saut de la foi) : il ne raisonne plus, il s’engage dans la subjectivité la plus radicale, car le paradoxe de la foi est tel qu’il excède toute raison (ex. : Abraham acceptant de sacrifier Isaac sans comprendre).
La foi est donc scandale et salut. Elle est l’acceptation de dépendre entièrement de Dieu, non par soumission extérieure, mais par liberté intérieure. C’est ici que Kierkegaard distingue l’homme religieux du simple croyant socialement conforme : l’authentique foi chrétienne est un engagement total, individuel, existentiellement bouleversant.
Ainsi, l’« individu » , figure centrale de Kierkegaard, n’est pas un égo enfermé en lui-même, mais un être en relation : avec lui-même, avec autrui, avec le monde et ultimement, avec Dieu.
VI. Comprendre et croire : deux rapports essentiels, deux renoncements
L’homme, en tant que « créature », est toujours tendu entre le désir de comprendre et la nécessité de croire. Kierkegaard distingue avec finesse ces deux rapports : comprendre est un horizon humain, c’est le rapport entre hommes, fondé sur la raison, la logique, le dialogue. Mais croire, au sens fort du terme, dépasse ce cadre, c’est un rapport à l’absolu, à Dieu, qui exige une abnégation de la raison pure. Croire signifie accepter humblement que nous ne possédons ni le pouvoir ni le devoir de tout comprendre. Cette humilité radicale est au cœur de la foi selon Kierkegaard : un engagement passionné et total dans l’au-dela de la raison, l’absurde, le mystérieux. Le saut de la foi est ainsi une décision libre et courageuse d’abandon, un consentement à l’inconnu, bien au-delà du domaine de la simple compréhension.
Découvrez cet article : Le Prophète, un livre de Khalil Gibran
Kierkegaard distingue la vérité objective, qui concerne les faits, les systèmes, les doctrines et la vérité subjective, qui est ce pour quoi on vit et meurt, ce qui engage l’être tout entier.
Cela ne signifie pas que la vérité est relative à chacun, mais que la vérité chrétienne, étant une vérité d’existence, ne se possède pas par démonstration. Elle se reçoit et se vit.
Le contraire de cette vérité vivante est ce que Sartre appellera plus tard la nausée : ce dégoût du monde, de soi, du sens, provoqué par la lucidité sans espérance. Sartre dira que l’homme est « condamné à être libre » , Kierkegaard dira plutôt qu’il est appelé à être soi, mais qu’il est libre de refuser cet appel, et tomber alors dans le désespoir, cette maladie qui consiste à ne pas vouloir être soi-même devant Dieu.
La seule issue, pour Kierkegaard, n’est pas dans une compréhension, ni dans un système rationnel, mais dans un saut de la foi : un acte paradoxal, inintelligible à la raison, par lequel le sujet accepte de ne pas comprendre pour entrer dans une confiance totale.
C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il critique le système philosophique de Hegel. Ce dernier, à ses yeux, incarne la tentation suprême de l’abstraction : celle de vouloir tout comprendre, tout réconcilier, tout intégrer dans une totalité rationnelle. L’histoire, la foi, l’individu, Dieu lui-même deviennent chez Hegel des moments dialectiques d’un système où rien n’échappe à la raison.Mais pour Kierkegaard, l’existence humaine réelle ne se laisse pas enfermer dans un système. La vie spirituelle n’est pas un enchaînement logique. Elle est décision, saut, drame. Ce qui définit l’homme, ce n’est pas l’achèvement du savoir, mais le vertige de la liberté.
« Le désespoir, c’est de vouloir se débarrasser de soi — et donc, en réalité, de vouloir se débarrasser de Dieu. »
Mais inversement, espérer, au sens où l’auteur l’entend, c’est accueillir le soi comme donné, comme tâche, comme appel. Ce n’est pas croire des dogmes, c’est aimer, aimer Dieu, son prochain, et soi-même en vérité.
VII. Le dédain de Kierkegaard pour la foule et la solitude de l’individu
Enfin, Kierkegaard nourrit un profond dédain pour la foule, cette masse anonyme, homogène, où l’individu se dissout et se perd. La foule est, pour lui, un lieu de médiocrité, d’inauthenticité, où le sujet ne se confronte plus à lui-même mais se laisse porter par des opinions, des normes collectives. Ce conformisme massif nie la singularité, l’exigence existentielle de devenir soi-même. La foule est pour lui une abstraction, c’est-à-dire une construction sans visage, une entité sans réalité propre, qui permet à chacun de se fuir lui-même.
Kierkegaard, à la fin du traité du désespoir (La Maladie à la mort) s’insurge. Il s’insurge contre son temps, contre la société bourgeoise danoise de son siècle, mais plus profondément encore contre ce qu’il nomme la « chrétienté » , par opposition au véritable christianisme. Cette dénonciation n’est pas une simple critique sociologique ; elle est spirituelle, théologique et existentielle.
Kierkegaard ne combat pas Dieu, il combat ce qu’on a fait de Dieu. Il n’attaque pas la foi, il attaque les formes mortes et dogmatiques qui prétendent la représenter. Comme un Luther renversé, Kierkegaard se dresse, non plus contre Rome, mais contre les autorités ecclésiastiques de son propre pays, qui ont réduit la foi à une affaire de respectabilité sociale, de conformisme culturel. La foule devient chez lui le nom générique de l’oubli de soi , car là où il n’y a pas de responsabilité individuelle, il n’y a ni amour, ni vérité.
La foule, pour Kierkegaard, n’est pas seulement un regroupement d’hommes ; elle est le refuge de l’irresponsabilité. Elle dissout l’angoisse de l’existence en opinions partagées, en conventions tranquilles, en vérités toutes faites.
Conclusion
La Maladie à la mort n’est pas simplement un traité sur le désespoir, c’est une méditation vertigineuse sur ce qui constitue l’essence même de l’existence humaine. J’avoue avoir été, à de nombreuses reprises, dérouté par cette œuvre. Bien que d’une intelligence rare, elle contraint le lecteur à dépasser certains cadres de pensée, ce qui peut s’avérer particulièrement éprouvant pour les esprits résolument athées ou agnostiques. Je me suis moi-même souvent cru saisi par l’éclair d’une compréhension, pour aussitôt retomber, quelques pages plus loin, dans les brumes de l’inintelligible.
Mais je pense que c’est précisément là que Kierkegaard nous attend : il ne nous propose pas de fuir le désespoir, mais de le regarder en face, d’en reconnaître non seulement le prix, mais la féconde nécessité afin de le dépasser. La foi de Kierkegaard n’est pas un simple système de croyances. Elle est relation, et cette relation est fondamentalement une relation d’Amour. Aimer, c’est ainsi répondre à l’appel à devenir soi. C’est sortir de l’abstraction pour entrer dans l’incarnation. C’est refuser la foule, non par mépris, mais pour retrouver la dignité du visage singulier.
Il faut rendre justice à Kierkegaard : selon moi, nul n’a mieux pensé la maladie du moi moderne, cette souffrance spirituelle qu’est le désespoir, ce refus, conscient ou non, de devenir soi sous le regard de Dieu. Mais cette radicalité existentielle, cette profondeur introspective qui perce jusqu’au plus intime du sujet, est aussi enfermée dans un cadre théologique, culturel et historique étroit, celui du Danemark du 19e siècle, dont il n’a jamais tout à fait su s’extraire.
Le vide que Kierkegaard appelle « désespoir » pourrait, dans une autre culture, n’être pas un manque à combler mais un espace d’accueil, un interstice fécond, une respiration dans le tissu du monde. La solitude devant Dieu, conçue chez lui comme exigence spirituelle, est peut-être une traduction historique du retrait plus fondamental du sens — mais il n’est pas sûr que cette traduction soit la seule possible, ni la plus juste aujourd’hui. Son cadre culturel : homogène, patriarcal, protestant, nordique façonne son anthropologie sans qu’il en ait toujours conscience. L’universalité qu’il revendique (le désespoir est « la maladie de tout homme ») s’ancre dans une subjectivité très particulière : l’homme lettré, isolé, occidental, hanté par Dieu et par lui-même.
Son père, homme austère et tourmenté selon ce que l’on en sait, lui transmet une vision du monde imprégnée de culpabilité, de solitude et de crainte divine, véritable matrice de sa pensée du péché et du désespoir. Sa rupture avec Régine Olsen, qu’il aime profondément mais sacrifie au nom de son appel spirituel, incarne son impossibilité de vivre l’amour humain sans conflit avec l’absolu…
Cela ne disqualifie en rien l’apport de Kierkegaard. Au contraire : il nous appartient de reprendre son feu sans sa cage. D’arracher à son époque ce qu’il a pressenti au prix d’une souffrance inouïe, et de le déployer dans des formes nouvelles. Son intuition du désespoir comme refus d’être soi ne doit pas être abandonnée, mais extrapolée dans une anthropologie élargie, capable d’accueillir la diversité des figures du moi, des relations à l’absolu, des langages du salut.
Car le désespoir n’est pas seulement une chute ; il est aussi, paradoxalement, la possibilité d’un éveil. En cela, il devient le sceau de notre humanité et, pour qui accepte de le traverser, le seuil d’un saut vers une vie authentique.
Dans cette œuvre où la philosophie et la théologie s’entrelacent, Kierkegaard ouvre selon moi un espace où l’homme est convié à s’affronter lui-même, jusque dans ses replis les plus secrets.
Sylvain Gammacurta
