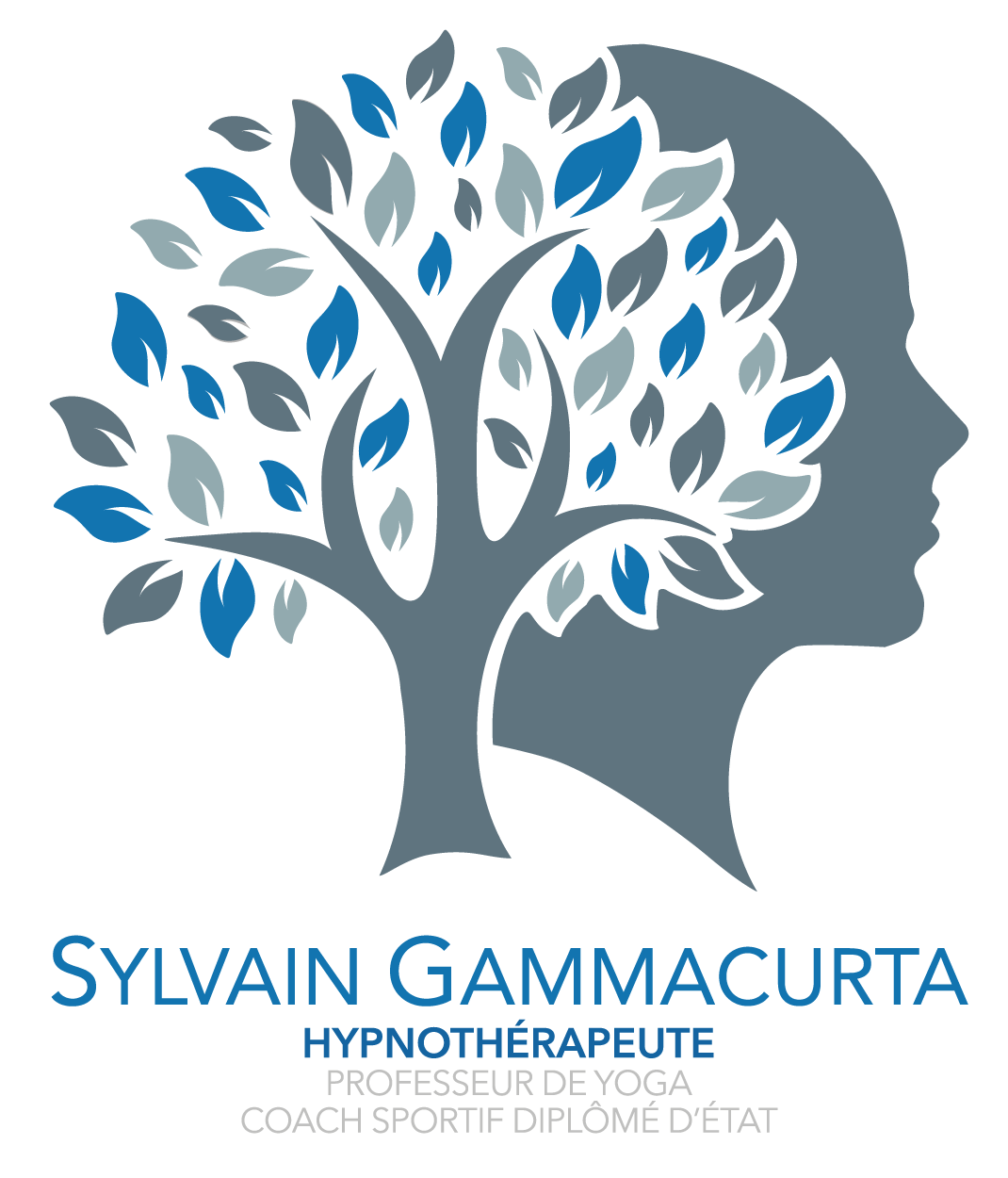Apologie de la discrétion : Comment faire partie du monde ?
Quel est le type de relation que chacun d’entre nous entretient avec le reste du monde, avec nous-même et avec la nature ?
Tel est le type d’interrogation que l’auteur tente ici d’analyser sous l’angle audacieux et déstabilisant d’un paradigme mathématique : “la discrétion”.
Sommes-nous en continuité les uns des autres ou existe-t-il une frontière nette entre chaque individu ?
Comme beaucoup le prétendent aujourd’hui, faisons-nous réellement partie d’un “Grand Tout” duquel il nous serait tout simplement impossible de nous extraire ou de nous concevoir isolément ?
Et surtout, quels sont les impacts de ces diverses conceptions et philosophies sur notre rapport à nous-même ou aux autres ?
Ce nœud gordien de l’articulation entre l’individuel et le collectif, et plus largement entre l’individu et le reste du monde, a stimulé de nombreux penseurs qui ont tenté de le trancher en puisant à des sources aussi variées que la philosophie, la sociologie, l’histoire, l’ethnologie, l’anthropologie, la psychologie, etc.
Tant de questions brillamment traitées par le neurologue Lionel Naccache qui, lui, a choisi de partir de l’idée de la discrétion au sens mathématique du terme.
« Nos dispositions naturelles et notre éducation culturelle […] concourent à rendre notre discrétion fondamentale fort discrète à nos propres yeux. »
Par cet article, je vais tenter de vous présenter son œuvre, aussi passionnante que déconcertante, en ne pouvant que vous conseiller, in fine, de vous procurer cet ouvrage.
Un mot sur l’auteur

Lionel Naccache, neurologue et universitaire français, s’impose comme une figure incontournable des neurosciences cognitives, explorant avec un éclat rare les mystères de la subjectivité et de la conscience individuelle. Professeur de médecine à la Sorbonne, il conjugue rigueur scientifique et sens de la métaphore dans ses travaux, qui font dialoguer sciences et humanités.
Dans son essai Le Cinéma intérieur, Naccache orchestre une rencontre fascinante entre les mécanismes du septième art et les subtilités de nos perceptions. Il y propose une théorie novatrice de la subjectivité, plaçant au cœur de son analyse ces « fictions-interprétations-croyances », ces récits que notre esprit tisse pour reconstruire le réel. Son écriture, tout en finesse et profondeur, offre un prisme captivant pour comprendre l’expérience humaine et le rôle des fictions dans la construction de notre identité.
Échantillonnage
Par échantillonnage, l’auteur entend le résultat de l’action qui consiste à isoler, au sein d’un ensemble mathématique, une suite discrète d’éléments parmi tous ceux qui le constituent.
C’est ce qui se passe au cinéma, par exemple : la caméra posée face à une scène visuelle échantillonne cette dernière à raison de 24 images par seconde.
La caméra produit donc une série discrète d’images fixes ordonnées à partir d’une structure temporelle continue de la scène visuelle initiale.
Maintenant, l’idée est de transposer cette notion à notre propre perception visuelle.
Bien que nous ayons l’intuition profonde de percevoir le monde de manière continue, les neurosciences nous révèlent une vérité fascinante : notre cerveau échantillonne également le monde visuel et crée cette impression de continuité subjective à partir des fragments discrets ainsi saisis.
Il échantillonne la scène visuelle environ 10 à 13 fois par seconde, capturant des « images » mentales discrètes.
Ce processus, cependant, ne s’arrête pas là : ces fragments visuels sont immédiatement travaillés, intégrés et enrichis par une myriade de facteurs tels que notre attention, nos croyances, nos émotions, nos attentes et nos connaissances préalables.
Le cerveau joue alors un rôle de “réalisateur” ou, comme l’exprime l’auteur, une “machine à mouliner en nous du discret en continu”.
Inconsciemment, il relie ces morceaux discontinus par un montage invisible, créant une impression subjective de continuité fluide.
Ainsi, ce que nous appelons la continuité visuelle n’est pas une donnée brute de la réalité, mais une construction active et créative de notre cerveau.
Nous inventons littéralement, à chaque instant, la continuité apparente du monde qui nous entoure, tout en restant largement inconscients de cette prouesse cérébrale.
Pour aller plus loin sur le sujet je vous conseille l’article suivant : « Le cinéma Intérieur de Lionel Naccache« .
La conscience de soi n’échappe pas au cinéma intérieur
Notre perception de notre propre corps repose sur un savant mélange d’informations issues de nos sens — la vue, le toucher, l’ouïe, l’odorat, le goût, mais aussi la proprioception, l’équilibrioception, la thermoception, la nociception — et l’interoception : ces sensations viscérales qui émanent de l’intérieur de notre organisme.
Mais loin d’être une captation brute et directe (exception pour l’odorat*), cette perception est le fruit d’un montage élaboré par ce que l’on pourrait qualifier de notre cinéma intérieur.
Les représentations que nous avons de nous-mêmes, cette impression de continuité intime et subjective de notre propre existence, sont ainsi le produit d’un processus actif de composition.
Notre cerveau tisse et façonne également un film intérieur où s’entrelacent sensations, émotions et croyances pour donner corps à ce que nous percevons comme « nous-mêmes ».
Cette réalité pose un défi vertigineux à l’injonction socratique du “connais-toi toi-même”. Car ce que nous croyons connaître – notre propre corps – n’est nullement une donnée immédiate, un accès direct à notre être.
C’est davantage une construction, une interprétation élaborée, une mise en scène incessante réalisée dans les profondeurs de notre esprit.
Connaître ce « soi » devient alors une entreprise doublement complexe : non seulement il faut explorer cette représentation, mais aussi accepter et comprendre les mécanismes invisibles qui la fabriquent.
“La forteresse de l’esprit humain, qui s’offre à nous comme un monolithe rassurant, se transforme soudainement en un château de sable effroyablement fragile dont chaque grain, à l’extrême, semble pouvoir être dissocié du reste de l’édifice.”
Approche Mathématique et Géométrique : Quand la culture renforce un penchant naturel
Dans ce livre, l’auteur a choisi d’utiliser une approche mathématique.
Vous l’aurez compris, la discrétion invoquée ici n’a rien à voir avec la définition usuelle du terme mais avec la notion mathématique des ensembles “discrets”.
Pour rappel, nous devons aux mathématiques une distinction fondamentale entre deux types d’ensembles : les ensembles discrets d’une part et les ensembles continus d’autre part.
“La différence entre le discret et le continu tient précisément à la relation entre chacun des éléments considérés isolément et le reste de l’ensemble. Dans un ensemble discret, chaque élément est non seulement distinct des autres, mais son existence individuelle est soulignée par le fait qu’il existe des frontières tranchées entre lui et les autres. Au contraire, dans un ensemble continu, il devient impossible de définir une frontière précise entre lui et eux.
Lionel Naccache, Apologie de la discrétion
Ainsi, la relation d’appartenance d’un élément à un ensemble continu se traduit par la perte de son individualisation au profit de sa fusion au sein de l’ensemble global.”
Comme exprimé dans son précédent livre, l’auteur souligne que les données immédiates de notre cinéma intérieur nous procurent l’impression de vivre dans un univers dont la structure spatiale et temporelle est continue.
Une continuité apparente de la structure de l’univers qui s’accorde harmonieusement avec le sentiment d’unité et de continuité temporelle subjective de notre propre conscience. Cette donnée immédiate de notre conscience de vivre dans un monde continu s’impose donc à nos yeux de manière intuitive mais se trouve également soutenue par des facteurs culturels et éducatifs qui renforcent encore plus notre adhésion à cette conception.
La géométrie enseignée à tous les enfants du monde depuis des siècles peut-être décrite comme la rationalisation de cette intuition immédiate et universelle d’une continuité spatiale de la scène visuelle. Une rationalisation dont le premier jalon historique a été cristallisé dans le joyau mathématique des “Éléments” d’Euclide.
Pour rappel, selon Euclide, une surface est composée d’une infinité de lignes dont chacune est composée d’une infinité de points. Nous sommes ici au royaume de la continuité. Impossible, par exemple, sur une ligne droite d’identifier deux points mitoyens : entre deux points, on trouvera toujours une infinité d’autres.
Euclide définit également qu’une ligne est une longueur sans largeur et qu’une surface est ce qui a seulement longueur et largeur.
Le prix à payer de cette première rationalisation de la fiction de la continuité spatiale consiste à ôter toute dimension spatiale à l’élément primordial de l’espace : un point ne possède ni longueur, ni surface, ni volume.
L’espace euclidien est donc composé d’une infinité d’éléments auxquels on a attribué une valeur de mesure spatiale nulle.
Il faut prendre conscience que le signifié d’un point abstrait n’a rien à voir avec son signifiant représenté concrètement sur une feuille de papier ou un tableau.
Un point mathématique n’a donc ni longueur, ni largeur, ni épaisseur, contrairement à son dessin.
Il s’agit ici d’une sorte de mutilation des propriétés d’allure discrète des constituants unitaires de l’espace (les points), transformés ainsi en support de continuité dont il ne reste rien de discret.
Autrement dit, pour Euclide, les points ne sont pas des atomes : s’ils sont bien insécables, ils n’ont aucune dimension.
La non dimensionnalité du point a pour conséquence qu’il est toujours possible d’introduire une infinité de points entre deux points donnés, si proches soient-ils.
Adieu la discrétion !
Les questions que la position d’Euclide soulève sont les suivantes :
- Comment passe-t-on du point à la droite, puisque le point n’a aucune dimension ?
- Comment des droites, dont chacune présente une largeur nulle, peuvent-elles produire la plus infime surface ? etc.
Pour l’auteur, accepter de tolérer un “abracadabra” longtemps incompréhensible révèle la puissance de cette intime conviction d’une structure continue de l’espace dont il fallait rendre compte à toute force.
La conception de la continuité, qui sous-tend la géométrie d’Euclide, se présente souvent comme une extension parfaitement rationnelle de notre intuition universelle et immédiate de la nature de l’espace.
Pourtant, il s’agit en réalité d’une forme d’hallucination conceptuelle : un produit de notre propension à fictionnaliser le monde, plutôt qu’une description absolue et incontestable de la structure fondamentale de l’espace et du temps.
La continuité n’est qu’une possibilité parmi d’autres, une construction mentale à laquelle nous accordons une attention privilégiée en raison de deux influences majeures. D’une part, elle s’appuie sur une intuition spontanée et intemporelle, presque irrépressible, que nous avons de l’espace comme étant fluide et ininterrompu.
D’autre part, cette intuition est renforcée et solidifiée par une éducation culturelle mathématique qui valorise et perpétue cette conception.
“La continuité à laquelle nous avons tendance à adhérer révèle bien du poids cumulé d’une intuition naturelle intemporelle, irrépressible, et d’une éducation culturelle mathématique influencée par cette intuition première.”
Lionel Naccache, Apologie de la discrétion
Théorie du neurone
En 1906, le prix Nobel de physiologie récompense à la fois Camillo Golgi pour l’invention de la coloration argentique et, pour l’autre moitié, Santiago Ramón y Cajal, pour la théorie du neurone. Cette dernière reçoit cette année-là une reconnaissance officielle qui permet d’établir ce qu’on pourrait appeler l’individualisme neuronal.
Le paradoxe réside dans le fait que, pour Golgi, il existe un véritable réseau de neurones dépourvu de frontières nettes entre eux : c’est la théorie réticulaire de Golgi.
Au contraire, pour Cajal, qui reprend pourtant les travaux de Golgi, « Les éléments nerveux possèdent des relations réciproques de contiguïté et non de continuité. »
Il faudra attendre quelques décennies (1954-1961) et l’apparition de la microscopie électronique pour donner (presque entièrement) raison à Cajal. Au niveau des zones de contact entre neurones, que sont les synapses, les membranes cellulaires sont effectivement séparées par une fente minuscule.
La théorie du neurone désigne la notion devenue fondamentale que les neurones sont les unités structurelles et fonctionnelles de base du système nerveux. Cette théorie fut d’abord formulée par Santiago Ramón y Cajal avant d’être complétée quelques années plus tard par Heinrich Wilhelm Waldeyer. C’est ce dernier qui proposa le mot « neurone » pour désigner les cellules nerveuses. Selon cette théorie, les neurones sont des entités fonctionnelles autonomes (et non fusionnées en un maillage).
Aussitôt démontrée, la description neuronale impose de mentionner cependant deux exceptions notables qui ne la disqualifient pas, mais éclairent la complexité des relations qui prévalent entre le discret et le continu lorsqu’on les envisage depuis le microcosme cérébral.
Le cerveau comporte, au-delà des seuls neurones, des cellules dites gliales, bien plus nombreuses que ces derniers. Ces cellules jouent un rôle crucial dans le fonctionnement cérébral. Parmi elles, les astrocytes se distinguent par leur implication directe dans les réseaux neuronaux. Non seulement ils soutiennent les neurones, mais ils participent également activement à la communication entre eux, en libérant des neurotransmetteurs qui influencent l’activité neuronale.
Les astrocytes présentent une organisation fascinante, qui rappelle sous certains aspects la théorie réticulaire formulée par Camillo Golgi. Leurs structures sont interconnectées par des canaux permettant des échanges directs de signaux biochimiques et ioniques à travers leur milieu intracellulaire. Cette continuité fonctionnelle entre astrocytes crée un réseau intégré jouant un rôle important dans la régulation et le soutien des circuits neuronaux.
Par ailleurs, il existe une autre particularité dans le cerveau qui fait écho à la vision réticulaire de Golgi : les jonctions communicantes, ou gap junctions, entre certains neurones. Ces jonctions permettent des phénomènes de couplage chimique, et surtout électrique, entre neurones adjacents. Au niveau de ces jonctions, deux neurones distincts sont mis en continuité l’un avec l’autre.
Cependant, il est important de noter que ces mécanismes de jonctions communicantes restent l’exception. Ils s’ajoutent en complément au mode de communication « discret » dominant entre neurones.
Démocrite et Épicure
Le tiraillement entre discrétion et continuité, si central dans notre perception du monde, trouve un écho profond dans la philosophie antique, notamment dans la pensée de Démocrite et d’Épicure. Ces deux figures, bien qu’appartenant à la même tradition atomiste, divergent significativement dans leur manière d’envisager les fondements de la réalité et leurs implications.

D’un côté, le fatum implacable et nécessaire de Démocrite ; de l’autre, la liberté hasardeuse d’Épicure.
Épicure, bien qu’il reprenne les bases atomistes de Démocrite, les remodèle pour répondre à une autre ambition : celle de réconcilier la réalité discrète avec l’expérience humaine de la continuité.
Pour Épicure, les atomes se déplacent certes dans le vide (chute en ligne droite, répulsion de nombreux atomes entre eux) ; c’est de cette manière que “des atomes finissent par se rencontrer”, et donc que “des mondes se forment”.
Mais il introduit une innovation capitale : le clinamen, ou déclinaison aléatoire.
Ce léger décalage imprévisible dans le mouvement des atomes permet d’expliquer l’émergence de la nouveauté, de la liberté et du hasard dans un monde autrement rigide et déterministe.
Là où Démocrite voit une mosaïque déterministe, froide et indifférente, Épicure cherche à inscrire la discrétion atomique dans une vision plus fluide et libre, en harmonie avec nos expériences humaines.
Le but est de libérer les individus de la peur des dieux et de la mort en leur montrant que le monde est compréhensible, prévisible, mais aussi compatible avec notre besoin de sens.
En réintroduisant volontairement une forme de continuité sans être inconscient de la discrétion, Lionel Naccache, dans la continuité d’Épicure, ouvre la voie à ce qu’il nomme “une éthique de l’atomisme sans vide”, c’est-à-dire une conception discrète de l’identité subjective consciente qui n’interdit pas l’établissement de liens par notre “comme si” de continuité.
Le cartésianisme assumé de l’auteur l’amène à préserver l’idée d’un cogito distinct, tandis que son adhésion au matérialisme de Marx l’incite à intégrer, dans la lignée de la théorie épicurienne du clinamen, une conception de la liberté individuelle.
Ainsi, l’homme en tant que sujet n’est pas enchaîné à un déterminisme rigide ou à un nécessitarisme aveugle.
Cette articulation permet de concevoir comment, même en considérant la primauté de la discrétion de la subjectivité individuelle, nous pouvons nous ériger en rempart contre les totalitarismes et les dérives solipsistes.
Autrement dit, contrer l’“égoïsme radical”, cette conception selon laquelle le moi, avec ses sensations et ses sentiments, constitue la seule réalité existante dont on soit sûr.
La discrétion radicale expose à l’égoïsme radical
Néanmoins, la conception subjective inspirée par le principe de discrétion radicale peut malheureusement mener à penser qu’un individu est une entité dépourvue de tout lien continu avec le reste du monde.
Il existerait entre lui et le reste du monde cette couche de vide chère aux atomistes antiques. L’existence subjective d’un tel individu ressemblerait à celle d’un empire dans un empire.
Or, “la psychologie et les neurosciences du développement cognitif de l’enfant ont depuis longtemps démontré l’impossibilité d’acquérir le langage et de nombreuses autres facultés indispensables à l’épanouissement individuel en l’absence d’un apprentissage socialisé intensif.
Sans interaction sociale précoce et durable, l’éclosion de cette riche subjectivité consciente adulte est tout simplement hors de portée.”
Pour l’auteur, le langage est ainsi la condition sine qua non de la possibilité même de se représenter subjectivement soi-même comme une entité discrète dénommable, et de se représenter quoi que ce soit d’autre sous une forme discrète.
L’accès à ce statut d’individu conscient et discret requiert donc une période d’extrême dépendance et de continuité.
Il faut bien comprendre que nul n’est immédiatement sous une forme consciente et discrète.
La discrétion radicale conduit ainsi l’individu qui l’a choisie sur la pente de ce que l’auteur nomme l’égoïsme radical, c’est-à-dire avant tout un égoïsme vis-à-vis des “je” qu’il a été dans le passé, notamment dans sa petite enfance, ainsi qu’avec tous les autres “je” qu’il sera lors de situations de dépendance existentielle passées ou futures : affective, médicale, socio-économique…
L’adoption subjective d’une posture de discrétion radicale correspond à une déconnexion subjective de chaque moment conscient vécu avec tous les autres moments conscients vécus, passés ou futurs.
Le danger est alors de croire que son autonomie est garantie et ne dépend en rien du reste du monde qui l’environne. Cela est extrêmement déresponsabilisant et peut mener aux pires horreurs.
La continuité radicale expose à la désubjectivation subjective et à la pseudo-continuité
Si la posture de discrétion radicale apparaît difficilement soutenable en raison des limites inhérentes à l’égoïsme extrême qu’elle engendre inévitablement, il reste à explorer où peut nous conduire, aux antipodes, le choix subjectif d’une continuité radicale dans notre rapport au monde qui nous entoure.
Se concevoir comme faisant partie d’un “grand tout” avec lequel nous serions en continuité expose, en premier lieu, à l’écueil fort curieux et paradoxal d’une conception subjective de soi asubjective.
Au bout du compte, ce qu’on appellera cette conscience globale d’un univers continu sera avant tout remarquable par son anti-intellectualisme et surtout par son caractère totalement asubjectif, du fait même d’une appartenance à une conscience collective supra-individuelle, voire cosmique.
L’extension prétendument continue de la conscience à l’ensemble de l’univers s’accompagne ainsi d’un appauvrissement non moins continu de ses contenus psychologiques qui convergent vers zéro.
La conscience du “Tout” est donc un nécessaire abandon de la conscience tout court.
En ce qui concerne la pseudo-continuité, c’est un tour de passe-passe qui se joue en deux temps.
Le premier mouvement consiste à croire partir vers cet au-delà de soi, tandis que le second revient à se prendre soi-même pour le dépositaire de la conscience de ce grand tout, dans lequel chacun de nous ne serait qu’une portion indifférenciée.
Au final, l’exercice ressemble plus qu’il n’y paraît à une autre forme d’égoïsme radical, alors même que ses adeptes s’imaginent incarner l’exact contraire d’un égoïsme. Cet élan vers un au-delà de soi, qui n’aurait en réalité jamais quitté le périmètre de notre narcissisme, peut se jouer avec plus ou moins de lucidité.
En réalité, la bienveillance revendiquée par cette posture généreuse et ouverte sur le monde ne saurait occulter sa dimension égoïste : décider de faire preuve de bienveillance et de gratitude à l’égard de parfaits inconnus revient à énoncer son désintérêt le plus absolu pour chacun d’entre eux.
Pour l’auteur, la pseudo-continuité revendique l’abandon de soi au profit de ce “grand tout”, mais procède en fait davantage à un hypercentrage de l’ensemble de l’univers autour de l’étroit nombril de ma personne.
À l’extrême, on peut se demander si la posture de bienveillance à l’égard du monde n’est pas ici motivée simplement par un hygiénisme individualiste, plutôt que par un principe moral d’altruisme.
Pour l’auteur : “La pseudo-continuité n’a pas le monopole de la bienveillance ni de l’éloge du corps et des sensations. Ces valeurs peuvent également être revendiquées avec discrétion.”
On remarquera ici que les deux risques associés à la conception de continuité découlent directement des propositions de L’Éthique de Spinoza, qui cherchait à penser l’unité du monde au-delà de soi, tout en ne pouvant échapper à sa condition de créature subjective consciente et discrète.
Un remède original : l’éthique de l’atomisme sans vide

Afin de contrer les affres de l’adhésion à un principe de discrétion radicale qui engendrerait un égoïsme radical d’une part, mais aussi au principe de continuité radicale qui mènerait inexorablement à l’un des deux écueils que sont la désubjectivation subjective et la pseudo-continuité, l’auteur propose l’éthique de l’atomisme sans vide.
Cette éthique adéquate du “faire partie du monde” doit être, selon l’auteur, fondée d’abord sur une lucidité du principe de discrétion qui est inhérent à notre statut naturel.
Chaque individu conscient devrait être pensé, par lui-même et par les autres, comme une entité discrète du monde auquel il appartient.
Une fois cette discrétion lucide solidement ancrée dans les représentations mentales, il est alors possible de s’engager dans un acte audacieux guidé par le principe de responsabilité et donc par le souci de cet ensemble discret dont nous faisons partie : savoir oser faire comme si nous étions engagés dans une relation de continuité avec nous-même et avec le reste du monde.
C’est-à-dire se montrer infiniment proche de lui et infiniment préoccupé par lui, tout en ne perdant pas de vue que ce souci procède d’une volonté individuelle affirmée par un être discret qui se tient debout face au reste du monde.
L’atomisme sans vide est donc un atomisme capable de jouer, d’interpréter ou de simuler à dessein la continuité.
En cela, l’atomisme s’invite à partager la célèbre formule de l’existentialisme sartrien : “l’existence (de l’individu) précède l’essence (de l’outre-soi)”.
L’empathie discrète et l’amour au cœur de cette éthique
L’empathie est sans nul doute la faculté première de notre vie sociale et intersubjective.
Il faut savoir en réalité que les neurosciences de l’empathie ont permis de révéler l’existence de deux types distincts d’empathie :
- D’une part, nous disposons d’une faculté involontaire, automatique, voire réflexe, qui nous fait subjectivement entrer en résonance avec ce que nous percevons d’autrui, comme si c’était nous qui vivions cette expérience, et non lui.
Cette “empathie miroir” présente toutes les caractéristiques d’une empathie pseudo-continue, qui consiste à croire éprouver ce que l’autre ressent alors que nous ne sommes jamais à la place d’autrui.
Cette empathie pseudo-continue est donc égoïste, sans adjoindre le moindre attribut péjoratif à ce simple état de fait.
Cette empathie miroir, qui remplit évidemment de précieuses fonctions, ne correspond donc pas à un souci d’autrui désintéressé de soi-même.
- D’autre part, nous avons également la possibilité de penser volontairement à ce qu’autrui éprouve, et de chercher à nous mettre à sa place tout en sachant qu’il s’agit de lui et non de nous.
Cette seconde forme d’empathie requiert un effort cognitif conscient et un temps plus long pour opérer.
Il faut savoir que l’empathie miroir automatique et l’empathie volontaire réfléchie reposent sur des réseaux cérébraux distincts et sont donc dissociables l’une de l’autre.**
C’est cette seconde forme d’empathie, cette empathie volontaire et surtout lucide de la distance qui me sépare d’autrui et de sa souffrance, qui répond au mieux aux attentes de cet altruisme désintéressé recherché par l’atomisme sans vide.
« L’empathie altruiste est ainsi nécessairement discrète, et non pseudo-continue.«
Enfin, l’union amoureuse exprime littéralement ce désir d’oser faire comme si l’on ne faisait qu’un, tout en sachant bien que cette fusion est illusoire.
En cela, deux êtres peuvent se connaître et s’aimer tout en échappant à l’égoïsme radical et à la pseudo-continuité, dès lors que leurs voix se répondent véritablement, sans que l’une objectivise ou asservisse l’autre à sa propre subjectivité.
“La relation amoureuse offre la possibilité de donner toute sa puissance à l’atomisme sans vide : deux individus lucides de leur discrétion respective s’engagent dans une relation d’outre-soi qui leur permet de vivre avec passion un désir de continuité.”
Conclusion
Dans Apologie de la discrétion, Lionel Naccache signe un essai d’une densité rare, mêlant rigueur scientifique et élégance littéraire.
Avec une plume fort plaisante et un esprit ouvert, il nous rappelle combien les neurosciences, loin de se cantonner à un laboratoire aseptisé, offrent des clés essentielles pour comprendre et transformer adéquatement le monde.
Ce texte, qui m’a tour à tour captivé, dérouté et émerveillé, est une démonstration magistrale de l’art du croisement des disciplines.
Si vous parcourez régulièrement mes articles, vous n’êtes pas sans savoir mon penchant pour le pluridisciplinaire et mon aversion pour les guerres de chapelles stériles.
Par ce livre, j’ai été séduit par l’auteur, qui ne se contente pas d’un regard neurologique strict : à travers les pages, il convoque en effet la littérature (Flaubert, Proust, Camus, Georges Perec), les mathématiques (Euclide, Grothendieck), la physique, embrasse la sociologie et s’enracine dans la philosophie.
Ce foisonnement témoigne donc d’une posture que je partage avec enthousiasme : celle d’un amour pour la pensée plurielle et les divers angles explicatifs.
Non sans humour et créativité, cet essai m’a non seulement permis de réévaluer certaines de mes propres conceptions, mais aussi de savourer une œuvre à la richesse incroyable, tant elle déborde de connexions et d’idées.
Le pari de cet essai est donc d’offrir une nouvelle vision du monde, où la lucidité et la responsabilité se conjuguent dans une quête perpétuelle de justice, de vérité et de beauté. Si la discrétion est ici exaltée, espérons que cet ouvrage sache sans affranchir au yeux du grand public 😉 .
Je ne saurais trop vous conseiller de le lire, de le savourer, et peut-être, comme moi, de vous y perdre pour mieux retrouver votre propre façon de “faire partie du monde”.
Apologie de la discrétion. Comment faire partie du monde ?, de Lionel Naccache, aux Éditions Odile Jacob disponible ici.
Sylvain Gammacurta
* Les fibres nerveuses ou naissent ces activités nerveuses olfactives vont directement gagner de grandes étendues de l’avant de notre cerveau, échappant à la gare de triage du thalamus. Les vastes territoires de notre cortex assujetti aux odeurs incluent 3 réseaux clés : celui qui sous-tend notre mémoire épisodique consciente, celui impliqué dans le codage de la balance émotionnelle des situations que nous vivons et celui qui participe directement à la conscience de soi. Bien qu’il y est un phénomène de transduction, l’olfaction est ainsi un sens qui se jette “immédiatement” à l’assaut de notre mémoire, de nos émotions et de la conscience de notre propre identité, sans filtre d’aucune sorte. C’est ainsi que l’auteur le considère comme “un sens dionysiaque” du fait de son échappée au contrôle thalamique et de son anatomie si particulière. A vrai dire le “nerf olfactif” n’est pas un nerf mais davantage une sorte d’appendice de notre cortex lui-même qui est en poste avancé au fond de notre nez, une sorte d’extension anatomique de notre cerveau.
**Le neurologue Nicolas Danziger a exploré cette question en s’intéressant à une population d’individus qui représentent une insensibilité congénitale à la douleur (Danziger, Faillenot et al. 2009, Danziger 2010)