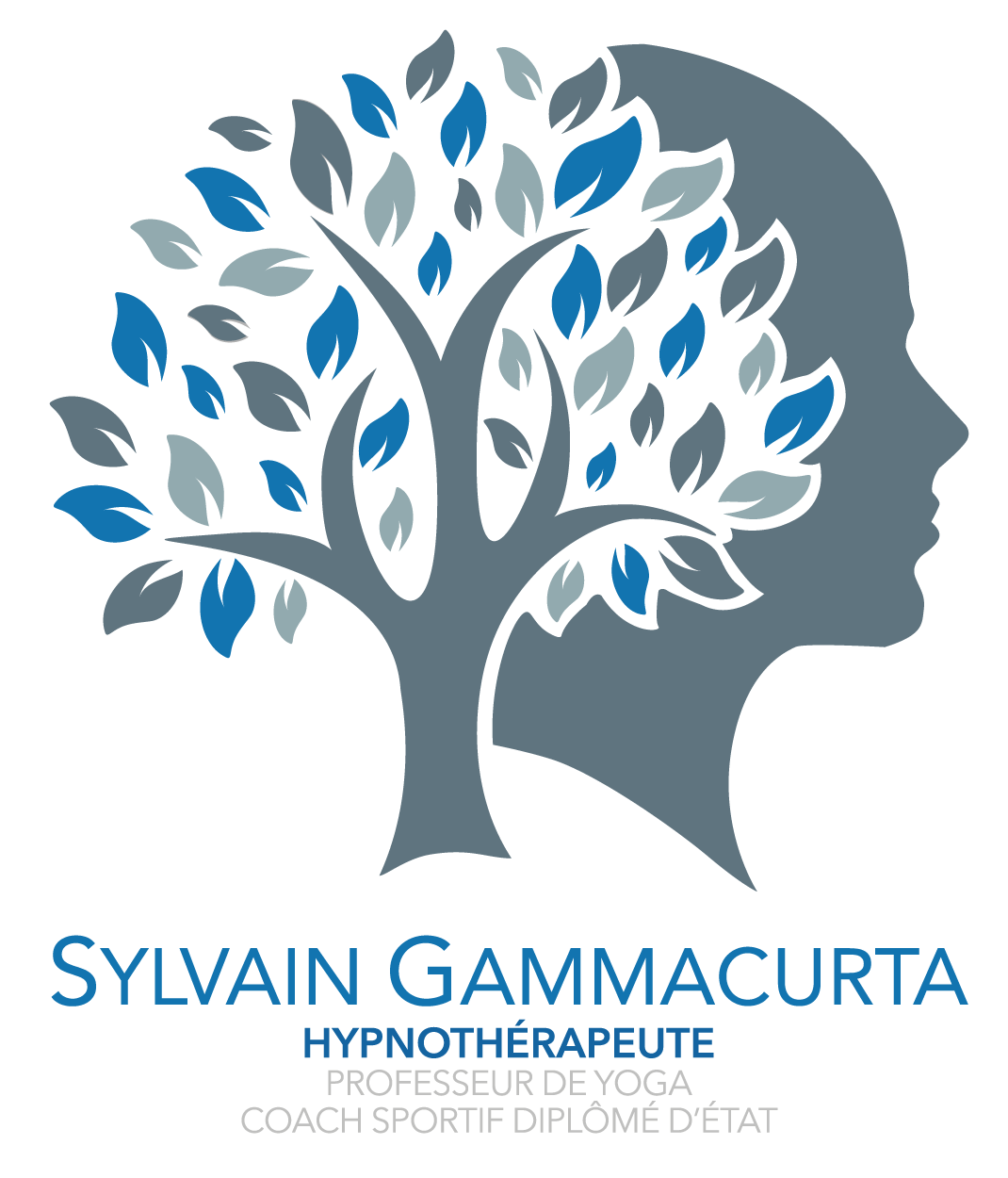Cette phrase, de nos jours parfois trop banalisé, condense une posture psychique, cognitive et relationnelle profondément problématique. Elle ne décrit pas seulement un simple « désaccord d’opinions » ; elle révèle une manière d’habiter le monde, de se rapporter à la vérité et à autrui.
À la suite d’une conversation légèrement houleuse, au cours de laquelle j’admets avoir perdu patience et sang-froid, faute de disposer d’une autre alternative interactionnelle viable, j’ai ressenti le besoin de revenir à ce qui à mon sens fonde l’humain comme être social : la reconnaissance de la légitimité de l’altérité. Non pas comme valeur morale abstraite, mais comme condition minimale du dialogue, de la pensée et de la coexistence.
La pensée condensée dans l’assertion « Moi, je sais ce qui est vrai ; les autres sont dans leurs bulles » ou toutes autres variantes de ce genre, ne relève pas d’un simple jugement ponctuel, mais instaure une posture globale à l’égard de la vérité, du savoir et de l’altérité. Elle présuppose que la vérité est immédiatement accessible au sujet, qu’elle est déjà constituée et définitivement acquise, et que les désaccords n’expriment pas des divergences interprétatives légitimes, mais l’enfermement cognitif d’autrui. Un tel raisonnement tend à produire une forme d’autosuffisance intellectuelle qui se protège contre toute remise en question, au prix d’un appauvrissement à la fois critique et relationnel.
Une rigidité relationnelle
Sans chercher à essentialiser, car je considère que toute essentialisation est intellectuellement fautive ou du moins maladroite, on observe que les personnes adoptant ce type de discours présentent souvent une rigidité marquée face au dialogue. Elles refusent de suivre les faits lorsqu’ils contredisent leur position, et se montrent incapables de se remettre en question, y compris lorsque des données empiriques solides, des travaux scientifiques ou l’expertise de professionnels reconnus sont mobilisés…
Il serait erroné d’y voir immédiatement une pathologie. Ces postures peuvent être situationnelles, contextuelles, défensives. Néanmoins, lorsqu’elles se répètent, elles s’inscrivent fréquemment dans des mécanismes de défense peu fonctionnels, parfois construits au fil d’évitements successifs de réalités psychiques difficiles à intégrer. Le refus de recourir à un professionnel de santé ou de l’accompagnement, souvent disqualifié a priori, contribue alors à rigidifier ces mécanismes et à complexifier durablement les relations sociales.
Sur le plan interactionnel et communicationnel, ces personnes interrompent fréquemment leur interlocuteur, ne le laissent pas terminer, imposent leur cadre interprétatif et invalident toute tentative de nuance, nous parlons ici de « disqualification interactionnelle« . Il ne s’agit pas d’un échange visant la compréhension mutuelle, mais d’une lutte pour le contrôle du sens. La communication devient asymétrique et imposée :
« Moi, je sais ce qui est vrai à partir de mon expérience personnelle, et rien ne me fera réviser ma position. »
Une telle position ne ménage aucun espace pour le dialogue. Elle ne formule pas un désaccord mais opère une disqualification préalable : « les autres sont enfermés ». Au-delà de la condescendance explicite et de l’affichage décomplexé d’une posture de supériorité, l’altérité cesse d’être un partenaire de sens pour devenir un simple symptôme. La parole d’autrui est ainsi invalidée d’emblée, non sur la base de ce qu’elle énonce, mais en raison de celui qui la porte. Le sujet se replie alors dans une réalité close, proche d’un solipsisme pratique, où seule sa propre réalité est tenue pour réelle, tandis que l’autre est systématiquement réduit à l’aveuglement ou à l’erreur.
Le philosophe Emmanuel Levinas rappelle que la relation à autrui commence précisément là où ma compréhension est mise en défaut. Refuser cette mise en défaut, c’est refuser l’altérité comme telle. Le dialogue devient impossible, car toute parole adverse est interprétée non comme une contribution, mais comme une preuve supplémentaire d’aveuglement.
À ce stade, on ne parle plus de débat, mais de clôture relationnelle.
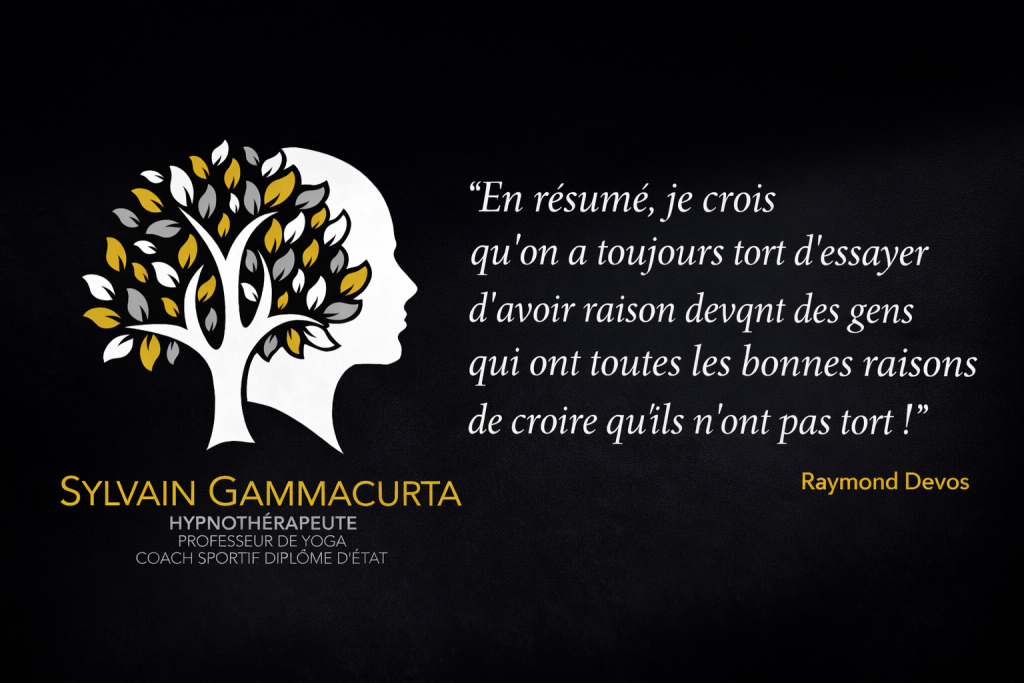
Fermeture et intolérance à la complexité
Sur le plan cognitif, cette posture correspond étroitement à ce que la psychologie cognitive décrit comme une fermeture cognitive.
L’individu recherche des réponses rapides, définitives, simples, bien souvent binaire. L’incertitude est vécue non comme un espace de recherche, mais comme une menace psychique.
La complexité, la nuance, le doute deviennent insupportables. Or, il me semble que toute pensée rigoureuse suppose précisément la capacité à tolérer l’incomplétude des savoirs. D’ailleurs, sur le plan épistémologique, je pense que l’on peut parler de dogmatisme, non pas au sens moral du terme mais au sens strict : un rapport à la vérité qui confond conviction subjective et savoir objectivé.
Le désaccord, une pensée différente n’est plus reconnu comme légitime. Cela est perçu comme une erreur, une ignorance, ou une attaque.
Or, comme le rappelait K.Popper dans un registre scientifique, ce qui distingue une pensée rationnelle d’une pensée dogmatique n’est pas qu’elle ait raison, mais qu’elle accepte le risque d’avoir tort.
Cette rigidité protège généralement contre l’angoisse du doute, mais empêche le remaniement de la pensée. Elle favorise ce que l’on peut appeler une pensée complaisante : une pensée qui se confirme elle-même, sélectionne les informations congruentes (biais de confirmation) et évite toute confrontation réelle.
Dans le but de théoriser une sociologie en opposition dialectique à l’aliénation, Harmut Rosa propose la définition suivante de ce qu’il nomme « la résonance » :
. »..une sorte de relation au monde, formée par l’affect et l’émotion, l’intérêt intrinsèque et l’auto-efficacité perçue, dans laquelle le sujet et le monde sont mutuellement affectés et transformés.
La résonance n’est pas un écho, mais une relation réactive, exigeant que les deux parties s’expriment de leur propre voix. Cela n’est possible que lorsque des évaluations solides sont affectées. La résonance implique un aspect d’inaccessibilité constitutive.
Les relations résonnantes exigent que le sujet et le monde soient suffisamment « fermés » ou cohérents pour pouvoir chacun parler de sa propre voix, tout en restant suffisamment ouverts pour être affectés ou atteints l’un par l’autre.
La résonance n’est pas un état émotionnel, mais un mode de relation neutre par rapport au contenu émotionnel. C’est pourquoi nous pouvons aimer les histoires tristes »
Hartmut Rosa, Resonance: A Sociology of our Relationship to the World, Polity, 2019
En d’autres termes, nous pouvons considérer la résonance non comme un écho passif mais comme une relation responsable et réactive dans laquelle chaque partie « parle de sa propre voix ». Cette caractérisation met en avant des conditions qui, si elles étaient traduites dans une discussion humaine, impliqueraient :
- que chacun puisse dire quelque chose de significatif pour lui-même (non simplement instrumentalisé ou réduit à une réponse stratégique) ;
- que l’échange permette une transformation mutuelle (chaque participant est touché par l’autre) ;
- que la relation ne soit pas purement instrumentale, hostile ou contrôlante (ce qui, pour Rosa, produit des expériences silencieuses, non résonantes).
Défenses narcissiques et toute-puissance
Sur le plan psychodynamique, plusieurs concepts sont pertinents (sans poser de diagnostic, ce qui serait évidement illégitime).
On retrouve néanmoins fréquemment :
- une position de toute-puissance défensive,
- un usage massif de la projection,
- une catégorisation réductrice de l’autre,
- et ce que certains auteurs nomment une résistance narcissique à l’altérité.
Cela se traduit par une incapacité à supporter que l’autre pense autrement sans que cela soit vécu comme une attaque personnelle. La certitude subjective est confondue avec la vérité objective, et le dialogue se transforme en monologue défensif.
Lorsqu’un désaccord surgit, plusieurs postures sont possibles. Deux méritent d’être distinguées clairement.
- La première est celle que certains appellent l’homme de fer (steel man), qui consiste à comprendre la position de l’autre dans sa version la plus cohérente et la plus forte. Cette posture exige une plus grande maturité intellectuelle et affective, mais elle est la seule qui permette d’apprendre quelque chose.
- La seconde est la posture de l’épouvantail (straw man), qui consiste à caricaturer, disqualifier ou ridiculiser la position adverse, souvent en attaquant la personne plutôt que l’argument : son âge, son sexe, son milieu social, son supposé “monde irréel”.
Dans ce cas, on ne débat plus d’idées, mais de statuts.
L’illusion de compétence et l’effet Dunning–Kruger
Un cadre empirique solide permet d’éclairer ce phénomène : l’effet Dunning–Kruger.
Son point central n’est pas que « les incompétents sont stupides », mais que les personnes peu compétentes dans un domaine manquent précisément des compétences métacognitives nécessaires pour reconnaître leur incompétence.
Autrement dit : elles ne savent pas qu’elles ne savent pas.
Cet effet est statistique, non moral. Il ne décrit pas une essence, mais une tendance universelle : nous y sommes tous sujets, à des degrés variables. Néanmoins en avoir conscience est déjà une manière de le réduire. Le problème survient lorsque cette illusion de compétence se rigidifie et s’accompagne d’une immunisation des croyances.
Toute information contraire est rejetée avec condescendance non parce qu’elle est fausse, mais parce qu’elle est menaçante.
Autrement dit, plus un individu se croit lucide et rationnel, plus il tend à sous-estimer ses propres angles morts.
Cette phrase produit donc un paradoxe performatif, elle dénonce l’enfermement cognitif tout en s’y installant...
Dissonance cognitive
Dans ce contexte, l’objection est vécue comme une attaque personnelle. L’argument est disqualifié en disqualifiant l’interlocuteur.
Psychologiquement, le dénigrement remplit une fonction très précise, à savoir restaurer une position de supériorité menacée, éviter l’expérience intérieure du doute, protéger une estime de soi souvent dysfonctionelle.
Freud parlait ici de mécanismes de défense narcissiques.
Leon Festinger a montré, avec la dissonance cognitive (A Theory of Cognitive Dissonance, 1957), que face à une information menaçant une croyance centrale, l’individu préfère souvent rejeter la réalité plutôt que réviser sa position.
Dans ce cadre, ajouter des arguments peut paradoxalement aggraver le phénomène et éveiller des argumentations de plus en plus fallacieuses.
L’un des ressorts les plus utiliser tient généralement à l’usage de raisonnements apparemment logiques, mais en réalité fondés sur des syllogismes défectueux et des biais cognitifs bien documentés, au premier rang desquels figure « le biais du survivant ».
L’individu généralise à partir de sa propre trajectoire en affirmant que ce qu’il a vécu ne peut être nocif puisqu’il s’en estime sorti « intact ». Ce raisonnement confond l’expérience subjective avec une preuve, ignore les trajectoires invisibles de ceux qui ont souffert ou échoué, et fait l’économie d’une analyse statistique et contextuelle.
L’exemple type en est la légitimation des violences éducatives au motif d’en avoir soi-même reçu sans s’en dire affecté : ce type d’argument ne réfute pas les données empiriques montrant leurs effets délétères, il illustre au contraire une rationalisation a posteriori destinée à préserver la cohérence identitaire et à éviter l’expérience psychiquement coûteuse du doute. Ainsi, ce qui se présente comme une certitude issue de l’expérience relève moins d’une pensée rigoureuse que d’une stabilisation défensive des croyances, où la survie est indûment confondue avec la validité.
Une question de réflexivité, pas de morale
Par souci d’honnêteté intellectuelle, je me dois d’ajouter que nous pouvons tous adopter ponctuellement ce type de posture. La différence n’est pas morale, elle est réflexive.
Certaines personnes peuvent revenir sur leurs positions, d’autres non.
Le problème apparaît lorsque ce fonctionnement devient chronique, s’installe dans les relations proches — famille, amis, collègues — et s’accompagne d’un sentiment persistant d’être victime ou persécuté par le monde entier. Dans ce cas, un travail plus approfondi s’avère souvent nécessaire.
Encore faut-il accepter cette possibilité, et ne pas disqualifier a priori les professionnels de l’accompagnement. Le refus systématique de toute aide extérieure est souvent le dernier verrou d’un système défensif qui confond autonomie et isolement, certitude et fermeture, force et rigidité.
Article associé : https://gammacoachinghypnose.com/quand-le-bien-justifie-les-actes
Pour conclure : Penser, c’est accepter de vaciller, de douter, de réviser.
Cette affirmation va à rebours d’une conception spontanée de la pensée comme accumulation de certitudes. Elle s’inscrit au contraire dans une tradition philosophique longue, où le doute n’est pas un défaut de la pensée, mais sa condition de possibilité. La vérité, encore faudrait-il la définir, n’est pas un objet possédé, mais un processus révisable. Là où la certitude subjective se fige, la pensée se ferme.
Le penchant qui nous amène à « davantage raisonner pour avoir raison », pour condamner, s’indignier plutôt que pour comprendre, nous conduit malheureusement à nous enfermer, de manière aveugle, dans un cadre de pensées fait de biais et d’arrogance. Alors que le changement devient la seule certitude, tant au niveau social, médical, politique, que technologique, la capacité de chacun à réfléchir à sa propre réflexion (ou métacognition), et à faire preuve d’humilité intellectuelle, devient à mon sens une capacité vitale.
Dans le verbe même dialoguer, on retrouve « Le logos » qui n’est pas simplement une opinion privée ou un simple ressenti subjectif (qui mérite d’être exprimer à partir du moment où il est définit comme tel), mais une parole argumentée, structurée, orientée vers l’intelligibilité. Dialoguer implique donc une exposition réciproque à la raison de l’autre, et non la juxtaposition de monologues.Le préfixe « dia » lui, implique une médiation et une transformation : ce qui passe « à travers » n’en ressort pas intact. Dialoguer suppose donc le risque d’être affecté, déplacé, voire modifié par l’échange.
Mais dialoguer, de mon point de vue, c’est d’abord accepter que l’autre existe, aller à sa rencontre avec curiosité, c’est savoir écouter malgré la différence et les projections que j’ai sur lui.
Et selon moi, le dialogue n’est pas une simple alternance de prises de parole. Il suppose avant tout, si l’on souhaite véritablement dialoguer, la reconnaissance préalable de l’autre comme sujet pensant, irréductible à mes catégories. La pluralité humaine n’est pas un obstacle à la vérité, elle en est la condition politique et existentielle. Là où un seul point de vue prétend à l’absolu, le monde commun s’effondre. Aucun dialogue authentique n’est possible si chacun reste enfermé dans son cadre interprétatif… Et attention, tenter de comprendre l’autre ne signifie pas l’approuver, mais accepter simplement et avec curiosité que sa position puisse transformer la mienne, ou du moins me donner matière à réfléchir. Refuser ce risque, c’est transformer ce que l’on prétend nommer « le dialogue » en simple confrontation stratégique.
Une pensée qui exclut l’altérité se condamne généralement à la répétition, à l’appauvrissement, puis à la fermeture défensive.
« En résumé, je crois qu’on a toujours tort d’essayer d’avoir raison devant des gens qui ont toutes les bonnes raisons de croire qu’ils n’ont pas tort ! »
Raymond Devos
Sylvain Gammacurta
Sources :
- P. Watzlawick, Beavin, Jackson, Pragmatics of Human Communication, 1967.
- Need for cognitive closure, Arie Kruglanski, 1990
- Karl Popper, La logique de la découverte scientifique, 1934
- Kruger & Dunning, 1999
- L’Art d’avoir toujours raison, Arthur Schopenhauer
- Livre intéressant à ce sujet : https://www.fnac.com/a9674423/Ellliot-Aronson-Pourquoi-j-ai-toujours-raison-et-les-autres-ont-tort
- Levinas Totalité et Infini, 1961
- Harmut Rosa