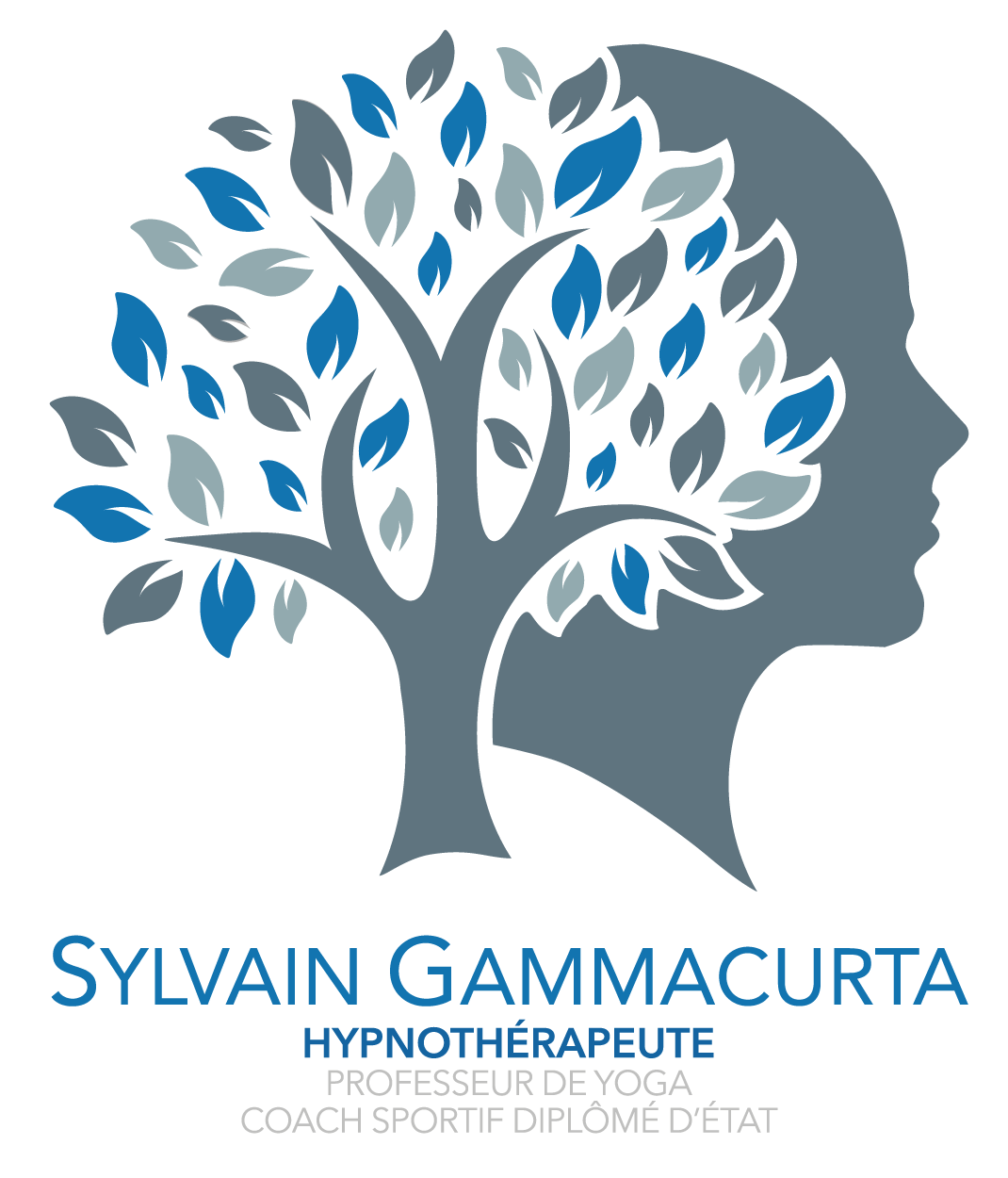L’Art d’avoir toujours raison
L’Art d’avoir toujours raison est un court manuscrit de Arthur Schopenhauer, rédigé probablement vers 1830–1831. Comme le mentionne le sous titre « La dialectique éristique« , il ne s’agit pas de dialectique au sens platonicien, orientée vers la vérité, mais d’éristique, c’est-à-dire de l’art de vaincre dans la controverse. Il s’agit donc d’arguments qui consistent à manipuler l’interlocuteur ou à le tenir en respect en le déstabilisant ou en l’agressant.
Schopenhauer y dresse un inventaire méthodique de nombreux stratagèmes observés dans les disputes ordinaires. L’ambition n’est ni morale ni pédagogique au sens classique, l’auteur ne cherche pas à enseigner comment bien raisonner, mais simplement à décrire comment les êtres humains raisonnent effectivement lorsqu’ils veulent avoir raison. Le texte repose sur un constat anthropologique assez pessimiste mais très souvent réaliste : dans la plupart des débats, le désir de vérité cède rapidement la place au désir de victoire.
Schopenhauer ne confond pas ces stratagèmes avec des arguments valides ; il les présente comme des procédés fallacieux, parfois efficaces psychologiquement mais dénués de valeur logique. L’intérêt du texte réside précisément dans cette lucidité presque clinique : en mettant à nu les ressorts de la mauvaise foi ordinaire, il fournit un outil d’observation précieux pour qui veut comprendre la dynamique réelle des échanges humains.
Il faut toutefois souligner une limite structurelle de l’ouvrage : Schopenhauer analyse la discussion comme un affrontement, et non comme une coopération . Il décrit admirablement ce qui fait échouer le dialogue, mais dit peu de ce qui permettrait de le réussir. Cette lacune explique que le texte gagne à être lu comme un contre-manuel, une cartographie des pièges à tenter d’éviter.
Les procédés rhétoriques centraux
Parmi les multiples stratagèmes décrits, certains me semblent particulièrement fréquents et méritent d’être explicités, tant ils structurent encore malheureusement nos échanges contemporains.
Un premier procédé consiste à déformer la thèse adverse en l’étendant abusivement. Une position nuancée et prudente devient soudainement une affirmation radicale, plus facile à attaquer.
Par exemple, dire : «Vous limitez la consommation d’écran pour votre enfant, donc vous jugez que les écrans sont mauvais.». Ce glissement caricatural permet de réfuter une thèse qui n’a jamais été soutenue. Ici la prémisse réelle est pragmatique et nuancée (régulation), la conclusion imputée est morale et totalisante et le glissement est implicite, donc difficile à déconstruire à chaud.
Nous sommes bien face à une caricature de la position initiale, non à une inférence valide.
Autres exemple intéressant et que je crois, nous avons tous rencontrer : Schopenhauer insiste sur l’usage massif de l’argument « ad hominem« . Lorsque l’argumentation faiblit, on s’en prend à la personne : ses intentions supposées, son incohérence passée, son statut social. « Vous dites cela parce que… » remplace « Ce que vous dites est faux parce que… ». La discussion quitte alors le plan rationnel pour devenir une évaluation morale ou psychologique.
Exemple concret : « Vous dites cela parce que vous êtes jeunes, dans votre bulle, dans le monde des bisounours, riche, pauvre, grand, petit, noir, blanc, un homme, une femme etc…»
« Ceux qui croient en Dieu ne sont que des naïfs ou des peureux. » ou au contraire « Les philosophes qui nient Dieu veulent juste se libérer de toute contrainte morale. »
Autre stratagème également courant : le déplacement de la charge de la preuve.
Celui qui affirme exige que l’autre démontre le contraire, parfois l’impossible. Par exemple : « Prouvez que cela n’arrivera jamais. » Ce renversement est logiquement infondé mais psychologiquement épuisant et redoutable. Dans un raisonnement valide, la charge de la preuve incombe à celui qui avance une affirmation. Celui qui nuance n’a pas à démontrer l’inexistence absolue d’un phénomène, surtout lorsque celui-ci est probabiliste, multifactoriel ou dépend de contextes variables (ce qui est, je crois, le cas de la majorité des phénomènes psychologiques et éducatifs).
Exemple concret : Dans un échange entre une personne favorable à une régulation prudente des écrans et un interlocuteur opposé à la restriction, le déplacement de la charge de la preuve peut prendre la forme suivante :
Partisan de la régulation et de la prudence :
« De mon côté, je choisis de m’appuyer globalement sur les recommandations d’âge (programmes déconseillés avant 12, 16 ou 18 ans) et de limiter l’exposition de mon enfant. Non parce que tout contenu serait nocif, mais par principe de précaution, notamment au regard des données existantes sur l’attention, le sommeil et la maturation émotionnelle. »Interlocuteur opposé
« Dans ce cas, prouvez-moi que ces contenus provoquent des symptômes concrets chez les enfants. Tant que vous n’êtes pas capable de montrer des effets négatifs clairs et systématiques, ces recommandations n’ont aucune valeur et il n’y a aucune raison de les suivre. »
Dans cet échange, la position initiale est modérée, contextualisée et non dogmatique : il s’agit de suivre des recommandations indicatives et d’adopter une attitude de prudence, non d’affirmer une nocivité universelle des écrans ou de programme spécifique.
Le stratagème consiste donc à exiger de cette position qu’elle fournisse une preuve directe et systématique de dommages observables comme condition préalable à toute régulation. Or cette exigence est méthodologiquement infondée pour plusieurs raisons. D’une part, les recommandations d’âge reposent rarement sur des relations causales simples et immédiates, mais sur des analyses statistiques, des corrélations, des facteurs de risque et des principes de précaution. Exiger des symptômes visibles chez chaque enfant revient à méconnaître le fonctionnement même des sciences du développement.
D’autre part, ce renversement fait porter sur la prudence une charge de preuve absolue, tandis que l’absence de régulation est implicitement considérée comme neutre et ne nécessitant aucune justification. La position la plus risquée se trouve ainsi présentée comme allant de soi. Ce stratagème produit un effet psychologique puissant : il place l’interlocuteur favorable à la régulation en position défensive, lui donnant l’impression qu’il agit sans fondement rationnel, alors même qu’il s’appuie sur des cadres institutionnels et scientifiques reconnus.
J’aimerai attirer également l’attention sur le stratagème 25 qui consiste à discréditer une affirmation générale en brandissant un contre-exemple isolé, présenté comme suffisant pour invalider l’ensemble de la proposition. Autrement dit : il suffit de trouver un cas qui ne rentre pas parfaitement dans la règle pour prétendre que la règle elle-même est fausse. Sur le plan logique, une loi universelle exige en effet une seule exception réelle pour être réfutée. Mais Schopenhauer montre que, dans les débats ordinaires, ce principe est détourné : l’exception invoquée est souvent mal comprise, mal définie, ou hors du champ réel de la proposition discutée.
Dans un débat sur la régulation des écrans par exemple, le stratagème peut apparaître ainsi :
« Les recommandations suggèrent de limiter l’exposition aux écrans chez les jeunes enfants. »
— « Pourtant, je connais un enfant qui passe beaucoup de temps sur les écrans et qui se porte très bien. Donc ces recommandations sont infondées. »
Ici, un cas isolé est utilisé pour invalider une tendance générale fondée sur des données statistiques et probabilistes. Le contre-exemple est présenté comme décisif, sans que l’on examine s’il est représentatif, ni même pertinent par rapport à ce que les recommandations affirment réellement. Dans les sciences humaines, en médecine ou en éducation, une règle n’implique jamais que tous les cas y soient soumis sans exception. Brandir un contre-exemple isolé permet donc surtout de donner l’illusion d’une réfutation, là où il n’y a qu’un déplacement du débat.
Schopenhauer décrit aussi l’argument de conséquence, qui consiste à rejeter une thèse non parce qu’elle est fausse, mais parce que ses effets seraient jugés dangereux ou dérangeants : « Si c’était vrai, ce serait catastrophique, donc ce n’est pas vrai. » La vérité est alors confondue avec le confort moral.
Exemple : « On entend parfois l’argument suivant : le monde extérieur est violent et incontrôlable ; tôt ou tard, les enfants y seront confrontés. Dès lors, chercher à les protéger de certains films, jeux violents ou situations serait inutile, voire naïf, puisque toute éducation finirait par être balayée par la réalité. »
Ce raisonnement ne réfute pas l’intérêt de la régulation : il la rejette parce que ses implications, reconnaître une responsabilité éducative et poser des limites, sont jugées trop contraignantes ou illusoires.
Ce raisonnement confond trois niveaux distincts :
- le fait que le monde comporte de la violence,
- l’impossibilité de tout contrôler,
- l’inutilité supposée de toute médiation éducative.
Or, le caractère imparfait d’une protection n’implique pas son inutilité, pas plus que l’existence d’un risque n’invalide la nécessité de tenter de faire au mieux pour l’anticiper. Ici, la thèse est rejetée non parce qu’elle est fausse, mais parce qu’elle dérange une posture fataliste rassurante et déresponsabilisation.
Tout au long du manuscrit l’auteur de l’Art d’avoir toujours raison met en lumière des procédés plus insidieux encore les uns que les autres: changer discrètement de sujet lorsque la discussion devient défavorable, invoquer un consensus vague (« tout le monde sait que… »), ou multiplier les objections secondaires jusqu’à épuiser l’interlocuteur, chercher à provoquer sa colère… Aucun de ces procédés ne vise la compréhension ; tous visent la domination symbolique.
Article sur le même sujet : « Moi, je sais ce qui est vrai. Les autres sont dans leurs bulles. »
Connaître ces procédés est essentiel pour un dialogue plus sain
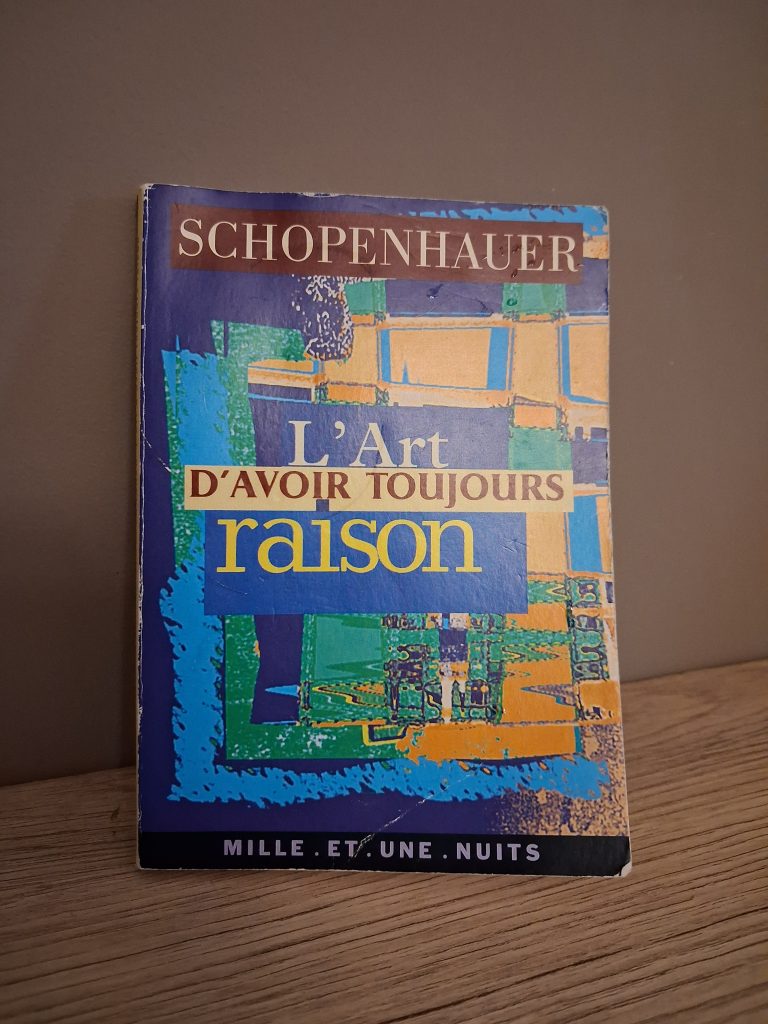
L’intérêt majeur de L’Art d’avoir toujours raison n’est pas d’apprendre à triompher dans les débats, mais à mon sens davantage à développer une vigilance critique. Connaître ces stratagèmes permet d’abord de résister à la tentation de les utiliser soi-même. Ils flattent l’orgueil, donnent l’illusion d’une victoire, mais appauvrissent la pensée et stérilisent la relation.
Communiquer de manière saine suppose d’accepter une idée parfois exigeante : avoir raison n’est pas toujours le but légitime d’un échange. Un dialogue véritable vise moins la confirmation de soi que l’épreuve de ses propres limites. Autrui, même lorsqu’il se trompe, peut révéler un angle mort, une approximation, une fragilité conceptuelle que nous ne percevions pas.
Connaître ces procédés est également indispensable pour ne pas en être victime. Lorsqu’un interlocuteur, consciemment ou non, utilise ces méthodes, il ne cherche pas à comprendre ni à co-construire un sens, mais à se rassurer, à discréditer, à maintenir une position de supériorité. Identifier ces mécanismes permet de ne pas se laisser entraîner dans une spirale stérile et de choisir, parfois, de se retirer plutôt que de nourrir une pseudo-discussion.
En ce sens, Schopenhauer rend un service paradoxal à l’éthique du dialogue. En exposant ce qui détruit la discussion, il nous invite indirectement à cultiver l’exact opposé : la précision conceptuelle, l’humilité intellectuelle, la capacité à suspendre son jugement et à reconnaître que la vérité n’émerge jamais d’un rapport de force, mais d’une rencontre.
A la fin de l’ouvrage, Schopenhauer décrit un ultime stratagème :
« Si l’on s’aperçoit que l’adversaire est supérieur et que l’on ne va pas gagner, il faut tenir des propos désobligeants, blessants et grossiers. Pour l’auteur, la seule parade sûre est donc celle qu’Aristote a indiquée dans le dernier chapitre des Topiques, : ne pas débattre avec le premier venu, mais uniquement avec des gens que l’on connaît et dont on sait qu’ils sont suffisamment raisonnables pour ne pas débiter des absurdités et se couvrir de ridicule, et dans le but de s’appuyer sur des arguments fondés et non sur des sentences sans appel, et pour écouter les raisons de l’autre et s’y rendre, des gens dont on sait enfin qu’ils font grand cas de la vérité, qu’ils aiment entendre de bonnes raisons, même de la bouche de leur adversaire […] Toutefois, en tant que joute de deux esprits, la controverse est souvent bénéfique aux deux parties, car elle leur permet de rectifier leurs propres idées et de se faire aussi de nouvelles opinions. Seulement, il faut que les deux adversaires soient à peu près du même niveau en savoir et en intelligence. Si le savoir manque à l’un, il ne comprend pas tout et n’est pas à niveau. Si c’est l’intelligence qui lui manque, l’irritation qu’il en concevra l’incitera à recourir à la mauvaise foi…«
Sylvain Gammacurta Hypnose
Références
- Schopenhauer, Arthur : L’Art d’avoir toujours raison
Trouver ce livre : https://www.fnac.com/a311107/Arthur-Schopenhauer-L-art-d-avoir-toujours-raison